Être ou ne pas être lecteur dans « Le Rouge et le Noir », de Stendhal

La première présentation de Julien Sorel est dans la scierie de son père, elle nous le montre en train de lire. La lecture occupe une place importante dans le récit, puisque Julien Sorel tout autant que Mathilde de la Mole s’inspirent des héros de leurs lectures.
Le roman de Stendhal, le Rouge et le Noir paru en 1830, s’inscrit dans la période d’alphabétisation dans les campagnes. Au XIXe siècle, le lectorat progresse notamment grâce au nombre croissant d’instructeurs laïques et religieux dans les campagnes, à la diffusion de la littérature de colportage, la multiplication des journaux qui publient des romans feuilletons. Les livres deviennent plus accessibles à tous, car leur prix diminue grâce aux nouvelles presses et des cabinets de lecture permettent de louer des livres en ville [1].
Le nombre de personnages de lecteurs augmente parallèlement dans les romans, car les auteurs s’intéressent particulièrement à ces nouveaux lecteurs venus du peuple [2]. Dans les années 1830, George Sand évoque par exemple la lectrice du peuple dans son roman André (1835), après avoir présenté les difficultés d’une princesse très savante dans le Secrétaire intime (1834). Dans ses romans, la fille du peuple comme la princesse affrontent le monde de la Restauration qui rejette ceux qui veulent sortir de leurs conditions, et d’autant plus si ce sont des femmes.

Comment Stendhal nous présente-t-il l’accès à la lecture
dans « Le Rouge et le Noir » ?
Lors de la première vague d’alphabétisation qui a touché les villes au XVIIe siècle et après le succès de Don Quichotte (traduit en 1605-1615), le lecteur était invité à rire des péripéties de ces nouveaux lecteurs, qui croyaient au livre sans détachement. Les élites s’amusaient de ces lecteurs novices prenant le livre comme parole d’évangile et guide.
Au XIXe siècle, lors de la seconde vague d’alphabétisation, les intellectuels romantiques, tels Mme de Staël ou Benjamin Constant, évoquent plus le tragique destin ce ceux qui ont trop lu, incompris sous la Restauration par une société mue par les valeurs de l’argent.
Stendhal s’en distingue et propose des personnages de lecteurs étonnants par leur positivité dans ce contexte romantique.
Julien Sorel : un lecteur du peuple
Dans le portrait de Julien Sorel, la lecture est tout d’abord ce qui le différencie de sa famille. Julien représente l’intellectuel de la famille. Lors de sa première apparition dans le roman, Julien est décrit en train de lire dans la scierie. Lire au lieu de travailler. La lecture est considérée comme une activité de fainéant et elle est d’autant plus haïe par son père, paysan enrichi analphabète [3], qu’il ne la maîtrise pas. Il frappe son fils surpris en train de lire et envoie le livre de Julien valser dans la rivière :
« Eh bien paresseux, tu liras donc toujours tes maudits livres, pendant que tu es de garde à la scie ? Lis-les le soir, quand tu vas perdre ton temps chez le curé, à la bonne heure.
Julien […] avait les larmes aux yeux, moins à cause de la douleur que pour la perte de son livre qu’il adorait [4]. »
Le Mémorial de Saint-Hélène est parti dans le ruisseau au grand désespoir du héros. Car ses livres lui ont été légués en héritage par un autre père spirituel, le vieux chirurgien major, qui a fait sa formation et lui a transmis son admiration pour Napoléon. Ils sont un héritage qui lui est cher, et qui est rare dans son milieu. Cette éducation lui a donné ses rêves de conquête et son modèle héroïque de référence : Napoléon.
La lecture va lui permettre son ascension sociale, puisqu’il est choisi comme précepteur des enfants de M. de Rênal, le maire de son village de Verrières.
L’activité de lecture plutôt que l’intérêt commercial en font un être à part. Aux yeux de son père, comme de M. de Rênal, Julien, jeune lecteur aux traits féminins est un être quasi asexué du fait de ces activités de lettré et de ses liens avec le curé, qui l’assimilent déjà à un séminariste. M. de Rênal l’introduit donc sans souci ni suspicion dans sa maison.
Il a tous les traits de l’enfant surdoué, hypersensible jusqu’aux larmes et à l’évanouissement. Très fier et rétif à l’autorité, il connaît par cœur de nombreux passages de la Bible et se fait une réputation dans Verrières en récitant à la demande ; il inspire ainsi le respect auprès des serviteurs de M. de Rênal en récitant de mémoire n’importe quelle page de la Bible. Il se donnera en spectacle lorsqu’il est invité à diner chez M. Valenod, tel un prodige dans ce village de campagne. Parmi ces lecteurs de livres de comptes, il a le même rôle divertissant que le chanteur italien qui vient un soir chez M. de Rênal.

Avec Mme de Rênal :
un premier amour innocent sans référence romanesque
Toutefois ses lectures restent limitées, et en amour, il reste candide puisqu’il n’a pas lu de romans.
« Certaines choses que Napoléon dit des femmes, plusieurs discussions sur le mérite des romans, lui donnèrent alors pour la première fois, quelques idées que tout autre jeune homme de son âge aurait eues depuis longtemps » (p. 69).
Et c’est d’abord dans l’idée de conquérir, tel Napoléon, qu’il approche Mme de Rênal, plus que par désir. Tout est intellectuel chez Julien, mais il ne connaît pas les codes de la séduction, seulement des notions de stratégie tirées de ses livres. Il se donne donc des défis et « son devoir, et un devoir héroïque » réalisé : lui prendre la main, il retourne à ses lectures.
« Rempli de bonheur […], il s’enferma à clef dans sa chambre, et se livra à la lecture des exploits de son héros » (p. 73).
La lecture in fine est donc sa première récompense. Par hasard il arrive à la séduire, et le narrateur s’amuse avec les clichés romanesques, dont il affirme son héros dépourvu en écrivant :
« On eût pu dire en style de roman qu’il n’avait plus rien à désirer » (p. 105).
Quant à Mme de Rênal, elle est décrite également comme vierge de toute lecture romanesque. L’absence de lecture lui permet donc de vivre avec Julien son amour en toute innocence :
« Comme Mme de Rênal n’avait jamais lu de romans, toutes les nuances à son bonheur, étaient neuves pour elle. Aucune triste vérité ne venait la glacer, pas même le spectre de l’avenir » (p. 98).
Ils vivent tous deux un amour passionné, tel Paul et Virginie, dans le best-seller de Bernardin de Saint Pierre [5], un amour dans l’environnement verdoyant de la maison de campagne, gêné seulement par la jalousie de la servante Élisa, évincée par Julien, ou du mari de Mme de Rênal.
Son mode de lecture chez M. de Rênal continue à l’assimiler aux jeunes filles vierges, lisant en cachette dans leurs lits, il est abonné au cabinet de lecture du village, ancêtre de la bibliothèque, et continue ainsi sa formation en lisant dans sa chambre des livres interdits sous le toit du maire. Une formation sexuelle, sentimentale et littéraire.
Un brillant séminariste, aux humanités révérées
Au séminaire, ses lectures le distinguent à nouveau. Elles lui nuisent pour son examen, quand il tombe dans le piège de l’examinateur, par péché d’orgueil, il cite avec élan Horace. Il révèle avoir lu des lectures non religieuses, les odes d’Horace plutôt que les saints pères de l’Église.
Néanmoins ses connaissances livresques lui permettent de converser brillamment avec l’évêque de Besançon, qui lui offre un bel exemplaire dédicacé de Tacite en plusieurs volumes à la tranche dorée. Ce don lui confère un statut immédiat, et grandit sa réputation au séminaire, plus encore que ses connaissances n’avaient su le faire auprès des fils de paysans.
Grâce à ses lectures, il parvient ainsi à gravir les échelons de l’échelle sociale jusqu’au poste de secrétaire du marquis de La Mole à Paris, où il rencontre une jeune fille lettrée, Mathilde de La Môle.

Mathilde de La Môle et Julien,
deux lecteurs en formations parallèles
Julien comme Mathilde aiment les livres et ils se rencontrent dans la bibliothèque du marquis de La Môle car Mathilde lit en cachette dans la bibliothèque familiale des livres normalement interdits aux jeunes filles de bonne famille. Julien la surprend :
« Le lendemain, de fort bonne heure, Julien faisait des copies de lettres dans la bibliothèque, lorsque Mlle Mathilde y entra par une petite porte de dégagement fort bien cachée avec des dos de livres […]. Julien lui trouva en papillotes l’air dur, hautain et presque masculin. Mlle de la Mole avait le secret de voler des livres dans la bibliothèque de son père, sans qu’il y parut » (pp. 287-288).
La jeune fille lectrice est immédiatement caractérisée par son apparence « masculine ». Contrairement à Julien, efféminé par ses lectures, elle se trouve masculinisée par celles-ci. Entrant dans un lieu réservé aux hommes, la bibliothèque paternelle, elle franchit les lignes de la séduction en passant ces limites. La lecture a le don de créer des passerelles entre les genres et de réunir dans une communauté ces êtres intellectuels.
Elle découvre les philosophes des Lumières, notamment Voltaire, et même si elle lit ses contes, elle s’éloigne des lectures morales convenant aux femmes de bonnes familles sous la Restauration. De plus elle apprécie les œuvres avec un personnage féminin fort, comme la Princesse de Babylone, seul conte de Voltaire avec un personnage féminin lecteur. Le narrateur ajoute, avec l’ironie qui caractérise Stendhal face à ses personnages :
« Cette pauvre fille, à dix-neuf ans, avait déjà besoin du piquant de l’esprit pour s’intéresser à un roman » (p. 288).
Elle n’est pas la seule à avoir ce goût romanesque. Julien apprécie aussi beaucoup ces œuvres et les lit en secret, ces lectures les rapprochent. Ils ne le lisent pas ensemble mais lisent le même ouvrage chacun dans sa chambre :
« Julien s’était assuré qu’elle avait toujours dans sa chambre un ou des volumes les plus philosophiques de Voltaire. Lui-même volait souvent quelques tomes de la belle édition si magnifiquement reliée. En écartant un peu chaque volume de son voisin, il cachait l’absence de celui qu’il emportait, mais bientôt il s’aperçut qu’une autre personne lisait Voltaire. Il eut recours à une finessede séminaire, il plaça quelques petits morceaux de crins sur les volumes qu’il supposait pouvoir intéresser Mlle de La Mole, ils disparaissaient pendant des semaines entières» (p. 364).
Ce type de lecture, Stendhal l’emprunte à son propre vécu adolescent qu’il rapporte dans son autobiographie, la Vie de Henry Brulard :
« Bientôt je volais les volumes de Voltaire dans l’édition en quarante volumes encadrés que mon père avait à Claix […]. Il y avait quarante, je pense, volumes serrés, j’en prenais deux et j’écartais un peu tous les autres, il n’y paraissait pas » (« Folio », Gallimard, pp. 103-104).
Cette lecture de l’adolescent dévorant en cachette les livres qui lui ont été interdits, ajoute un plaisir supplémentaire à la lecture.
Mlle de La Môle ne se contente pas de romans, elle lit tout : les ouvrages politiques, les pamphlets anticléricaux. Elle se délecte particulièrement des ouvrages de rébellion et elle connaît la mythologie, dans laquelle elle apprécie « Médée et les femmes fortes », soit toujours des modèles de femmes passionnées. Elle adore également, comme beaucoup de romantiques, l’histoire du Moyen Âge, dans laquelle elle puise des exemples d’amours violents, comme ceux de son ancêtre Boniface de La Mole. Ses lectures nous font donc découvrir une figure pleine de fougue, effectuant sa formation en autodidacte dans la bibliothèque de son père. Manon Roland, Germaine de Staël ou George Sand se sont ainsi formées dans la bibliothèque familiale, à défaut de vraies institutions pour les femmes, le couvent ne leur offrant pas une culture littéraire.

Mathilde, bas bleu[6], une pédante qui parle fort dans son salon
Le danger pour les femmes qui lisent est de sortir de la soumission et du silence imposés au sexe faible et de parler haut et fort, de chercher la gloire au lieu de chercher un époux. Dans le salon de son père, devant ses admirateurs attirés par sa beauté et sa richesse, Mathilde fait étalage de son esprit. Cet esprit supérieur ne peut que se désolidariser de son milieu. Elle ne trouve aucun prétendant avec un esprit équivalent au sien. Partie en voyage en Provence, elle s’attend à entendre mille sottises à son retour :
« Elle avait le malheur d’avoir plus d’esprit que MM. de Croisenois, De Caylus, de Luz, et ses autres amis. Elle se figurait tout ce qu’ils allaient lui dire sur le beau ciel de la Provence, la poésie, le midi, etc. » (p. 327).
Ses lectures la condamnent à la solitude, comme bien d’autres héroïnes lettrées de l’époque.
Balzac, dans Béatrix (1839), peint par exemple son héroïne, Camille Maupin, à l’image de son amie George Sand. Elle est intelligente, très savante, mais l’abbé la voit comme une « monstrueuse créature qui tenait de la sirène et de l’athée » [7], son intelligence la condamne à un destin de solitude sans amour, dans le roman.
Mathilde est de plus de nature exaltée, elle a nourri dans ses lectures ses désirs d’héroïsme, ne rêve que d’un héros qui sorte de l’ordinaire de façon extrême et ne connaît pas la mesure :
« Je ne vois que la condamnation à mort qui distingue un homme, pensa Mathilde : c’est la seule chose qui ne s’achète pas.
Ah ! C’est un bon mot que je viens de me dire ! Quel dommage qu’il ne soit point venu de manière à m’en faire honneur ! Mathilde avait trop de goût pour amener dans la conversation un bon mot fait d’avance ; mais elle avait aussi trop de vanité pour ne pas être enchantée d’elle-même » (p.332).
Stendhal en fait une walkyrie, une fille fière qui se sait supérieure, surdouée, à l’instar de Julien elle se trouve en décalage avec son milieu :
« L’esprit, j’y crois car je leur fais peur évidemment à tous. S’ils osent aborder un sujet sérieux, au bout de cinq minutes de conversation, ils arrivent tout hors d’haleine, et comme faisant une grande découverte à une chose que je leur répète depuis une heure. Je suis belle, j’ai cet avantage pour lequel Mme de Staël eût tout sacrifié, et pourtant il est de fait que je meurs d’ennui » (p. 335).
Stendhal dessine son héroïne avec les traits de la jeune Germaine de Staël qui brillait dans le salon de ses parents. Il ajoute une petite pique avec cette référence à la beauté de Germaine de Staël, pour laquelle il partageait à la fois admiration et répugnance [8]. L’attaque est traditionnelle, au XVIIe siècle, dans les caricatures, la femme savante était décrite comme peu séduisante, choisissant la science à défaut de pouvoir séduire [9]. Il donne à son héroïne beauté et savoir, ainsi qu’un puissant refus du conformisme et des règles établies.
Alors que son père voudrait lui faire épouser un duc, Mathilde va s’intéresser au seul être qui ne la regarde pas avec fascination, Julien, le simple secrétaire de son père. Car ainsi venu du peuple, il lui semble un nouveau Jean-Jacques Rousseau, lorsqu’il déclare passer sa vie à écrire et n’aller jamais au bal. Elle a lu les Confessions, or Julien la surprend par sa culture comme Rousseau raconte avoir surpris les convives du comte chez lequel il était simple secrétaire. D’un secrétaire de comte à l’autre, l’identification est rapide. Mathilde et Julien connaissent Rousseau ; Julien l’étonne lorsqu’ils évoquent le philosophe des lumières :
« – J.-J. Rousseau n’est à mes yeux qu’un sot lorsqu’il s’avise de juger le grand monde […].
– Il a fait le Contrat Social, dit Mathilde du ton de la vénération.
– Tout en prêchant la République et le renversement des dignités monarchiques. Ce parvenu est ivre de bonheur si un duc change la direction de sa promenade après diner pour accompagner un de ses amis.
– Ah oui le duc de Luxembourg à Montmorency. Reprit Mlle de la Mole avec le plaisir et l’abandon de la première jouissance à la pédanterie. Elle était ivre de son savoir. […] L’œil de Julien resta pénétrant et sévère. Mathilde avait eu un moment d’enthousiasme ; la froideur de son partner la déconcerta profondément. Elle fut d’autant plus étonnée que c’était elle qui avait coutume de produire cet effet là sur les autres » (p. 331).
Mathilde n’étant pas adulée par Julien trouve là un héros de roman qui plaît à cette âme rêvant d’héroïsme, un nouveau Jean-Jacques Rousseau, auquel elle va se donner, par un élan qu’elle pense héroïque, tiré de ses lectures des philosophes des lumières.
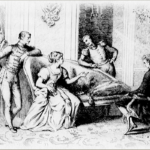
La femme lettrée, un monstre
Mais pour Julien, l’esprit de Mathilde de La Mole n’est pas une qualité admirable, bien au contraire, il l’inquiète, le terrifie. Ses lectures de séminariste l’ont poussé à voir dans la femme le démon, et surtout dans les intellectuelles. Il suit l’anathème de J.-J. Rousseau, dans Émile ou de l’éducation (1761), qui écrit : « Toute fille lettrée restera fille toute sa vie tant qu’il n’y aura que des hommes sensés sur la terre [10] » et, en digne émule du philosophe, l’intellectuelle lui fait peur. L’éducation de la jeune femme comme sa noblesse et son identité de Parisienne en font pour Julien un être terrifiant :
« Julien s’exagérant cette expérience, croyait à Mlle de la Mole, la duplicité de Machiavel. Cette scélératesse prétendue était un charme à ses yeux, presque l’unique charme moral qu’elle eut. […]. Il la croyait une Catherine de Médicis. Rien n’était trop scélérat pour le caractère qu’il lui prêtait. […]. C’était en un mot pour lui l’idéal de Paris » (pp. 366-367).
La Parisienne, terrible et monstrueuse, s’oppose à son premier amour, la douce Mme de Rênal, la provinciale de la campagne, non-lectrice. Là encore les références rousseauistes perdurent : la campagne est le lieu de la pureté contrairement à la ville corrompue ; une mère affectueuse et tendre face à une héritière de la grande noblesse comparée à un démon.
« Lui faire peur. S’écria-t-il tout un coup en jetant le livre au loin. L’ennemi ne m’obéira qu’autant que je lui ferai peur. Alors il n’osera me mépriser. […] C’est un démon que je subjugue. Donc il faut subjuguer » (p. 374).
Subjuguer, maîtriser, mater, séduire le démon, tels sont les mots des religieux qui l’ont formé au séminaire pour qualifier les femmes. En 1831 un an après la publication du Rouge et le Noir, paraît Notre-Dame de Paris où le prêtre Frolon perçoit Esmeralda comme un démon.

Une folle épouse entrainée par son imagination débordante
Les lectures de Mathilde l’invitent à rêver de relations passionnées, comme celles d’Emma Bovary le feront en 1856. Emma n’aura lu que des romans feuilletons ou des romans sentimentaux, Mathilde a une plus grande culture des succès romanesques du XVIIIe siècle :
« Elle repassa dans sa tête toutes les descriptions de passion qu’elle avait lues dans Manon Lescaut, La Nouvelle Héloïse, les Lettres d’une religieuse portugaise, etc. Il n’était question bien entendu que de la grande passion, l’amour léger était indigne d’une fille de son âge et de sa naissance. Elle ne donnait ce nom d’amour qu’à ce sentiment héroïque, que l’on rencontrait en France du temps de Henri III, et de Bassompierre. Cet amour-là ne cédait point bassement aux obstacles ; mais bien loin de là faisait faire de grandes choses » (p. 357).
Même si elle a lu d’autres références que des romans d’amour, ou romans feuilletons, les philosophes des Lumières n’ont pas fortifié suffisamment cette âme exaltée, elle imagine Julien en héros chevalier, dès qu’elle le voit avec une épée :
« Mlle de La Mole le regardait étonnée. J’ai donc été sur le point d’être tuée par mon amant. Se disait-elle. Cette idée la transportait dans le plus beau temps du siècle de Charles XI et de Henri III. […] Je vais retomber dans quelques faiblesses pour lui, pensa Mathilde […]. Elle s’enfuit » (p. 395).
Elle a conscience d’être emportée par son désir de vivre des aventures romanesques. Elle se donne à lui dans un élan qu’elle regrette ensuite, lorsqu’elle retombe de son rêve. Elle lui dit alors :
« Je ne vous aime plus, Monsieur, mon imagination folle m’a trompée » (p. 414).
Elle est capable d’un moment de lucidité pour analyser son excès mais il suffit d’un instant pour que l’illusion revienne.
Telle Don Quichotte, elle s’enthousiasme pour une vie héroïque et s’imagine en gente dame avec son chevalier. Mais alors qu’au XVIIe siècle, Don Quichotte était décrit comme un fou souffrant d’un dédoublement de personnalité, avec des accès violents de folie d’identification, au XIXe, Mathilde est un être pensant qui analyse ses emportements, en femme de tête, mais y perd sa vertu et réputation. Elle lui sacrifie tout : son honneur en révélant partout qu’elle est sa femme et se trouve enceinte de lui, sa vie même puisqu’elle lui propose de se tuer ensemble, lorsqu’il est condamné à mort :
« C’était de la folie de la grandeur d’âme, tout ce qu’il y a de plus singulier. Elle lui proposa sérieusement de se tuer avec lui. […] Elle examinait son amant qu’elle trouvait bien au-dessus de ce qu’elle s’était imaginé. Boniface de La Mole lui semblait ressuscité mais plus héroïque » (p. 520).
Vivre une action héroïque était son rêve. Finalement elle achève son roman avec Julien exactement comme elle le souhaitait de façon excessivement romanesque : elle emporte la tête de son amant décapité et va l’enterrer en secret de façon grandiose en Italie. Elle a réussi la grande scène qu’elle désirait, comme celle de son ancêtre de la Mole qui la faisait rêver.
 Mme de Rênal ou Mathilde de la Mole ?
Mme de Rênal ou Mathilde de la Mole ?
Julien la quitte avant de mourir pour revenir à Mme de Rênal. Mathilde de La Môle et Mme de Rênal ont pu parfois être présentées comme opposées : une grande lectrice et une femme sans lecture. Le critique Georges Castex, dans son étude du Rouge et le Noir en 1970, écrit à propos de Mathilde de La Mole :
« Il y a trop de romanesque et trop peu de naturel dans cet amour de tête, qui la conduit à s’humilier devant son maitre. Rien de véritable ne se construit en amour sans une tendresse véritable, mutuelle. Mathilde est trop compliquée, trop raisonneuse, trop entière. Aussi Julien s’aperçoit il, lorsqu’il a vu “clair en son âme”, qu’il a noué avec elle des liens factices. Elle peut bien se donner une ultime satisfaction romanesque en s’emparant pour l’ensevelir de la tête de son amant. En fait, il lui a échappé et elle apparaît finalement comme la grande vaincue du roman [11]. »
Cette lecture du roman apparaît aujourd’hui marquée par un « male gaze », un regard masculin, et datée. Au XXIe siècle, à l’ère de #Me too, une femme est-elle perdante parce qu’intelligente, elle aime avec toute sa tête et ses rêves, si elle n’a pas été choisie à la fin par un homme ?

Tout d’abord, l’autre héroïne de l’œuvre n’est pas moins portée aux élans passionnés, c’est le propre des héros de Stendhal de tendre vers un idéal avec excès. Mme de Rênal vit également son amour avec exaltation et élans passionnés. Elle alterne adoration de Julien et repentir religieux. Elle fait tout pour l’oublier et lorsqu’il réapparait, il emporte toutes ses défenses. Après avoir voulu l’empêcher de se marier, avoir été visée par son amant, elle le retrouve juste avant sa mort, et meurt trois jours après Julien. Elle est loin d’être une héroïne calme et mesurée, sans excès.
Ensuite, que désire la romanesque Mathilde ? Elle souhaite vivre un roman, elle veut revivre des amours aussi tumultueux que ceux qu’elle imagine à son ancêtre au Moyen Âge . Or Mathilde réussit, elle est victorieuse, puisqu’elle vit son rêve romanesque et qu’importe le « partner », comme le dit Stendhal. Elle réalise son rêve, sort des carcans qui lui imposaient un mariage de convenance avec un duc pour une ascension sociale de sa famille, un mariage rêvé par son père mais qui n’était pas son rêve à elle. Mathilde termine son roman seule mais elle a réalisé ses rêves héroïques, pleinement vécu son histoire.
Bien plus, cette jeune fille exaltée, égotiste, en quête d’idéal, n’est pas ridiculisée par Stendhal, elle n’est pas sans parenté avec son auteur, grand liseur de romans, séduit par Rousseau, lisant Voltaire et Don Quichotte.
Son héroïne se rapproche par son prénom de Métilde Dembowski, dont Stendhal était passionnément amoureux en 1818 sans que cela soit réciproque, elle emprunte aussi son caractère à son amie Méry de Neuville, qu’il décrit dans sa correspondance comme une femme d’exception au sein des nobles de son entourage :
« Cette fin me semblait bonne en l’écrivant, j’avais devant les yeux le caractère de Méry, jolie fille que j’adore. Demandez à Clara, si Méry n’eût pas agi ainsi. Les jeunes de Montmorency et leurs femelles ont si peu de force de volonté, qu’il est impossible de faire un dénouement non plat avec ces êtres élégants et effacés [12]. »
Stendhal valorise les femmes fortes et volontaires. Dans ses notes posthumes, on peut lire ce constat sur l’éducation de son temps :
« Par l’actuelle éducation qui est le fruit du hasard et du plus sot orgueil, nous laissons oisives chez elles, les facultés les plus brillantes et les plus riches en bonheur pour elles-mêmes et pour nous-mêmes [13] . »
Stendhal met deux femmes romanesques face au romanesque Julien : une parisienne passionnée, exaltée, grande lectrice et une femme mariée, en province sans lecture mais capable de créer son propre roman par amour, de façon tout aussi passionnée. Il laisse à ses lectrices et à ses lecteurs, le soin de choisir celle qu’ils préfèrent. Il écrit par exemple à une de ses amies, Mme Virginie Ancelot :
« Dites-moi si vous êtes piquée comme Mathilde ou comme Mme de Rênal ? » [14]
Mathilde lectrice exaltée au milieu des salons bien-pensants est une rebelle contre l’institution qui plaît à l’auteur, même s’il la décrit avec ironie. C’est un miroir dans lequel il se mire lui-même, dans ses élans romantiques de jeunesse, comme Flaubert déclarera « Madame Bovary, c’est moi ».
Après la Révolution, à une époque où la Restauration impose une morale plus stricte et limite les comportements déviants, Mathilde, au moment de la monarchie de Juillet, exprime l’esprit de rébellion qui pointe en 1830. Elle fait fi des barrières pour lui cacher les lumières du savoir et elle se bat pour réaliser ses rêves, s’offrir un destin correspondant à ses aspirations héroïques.
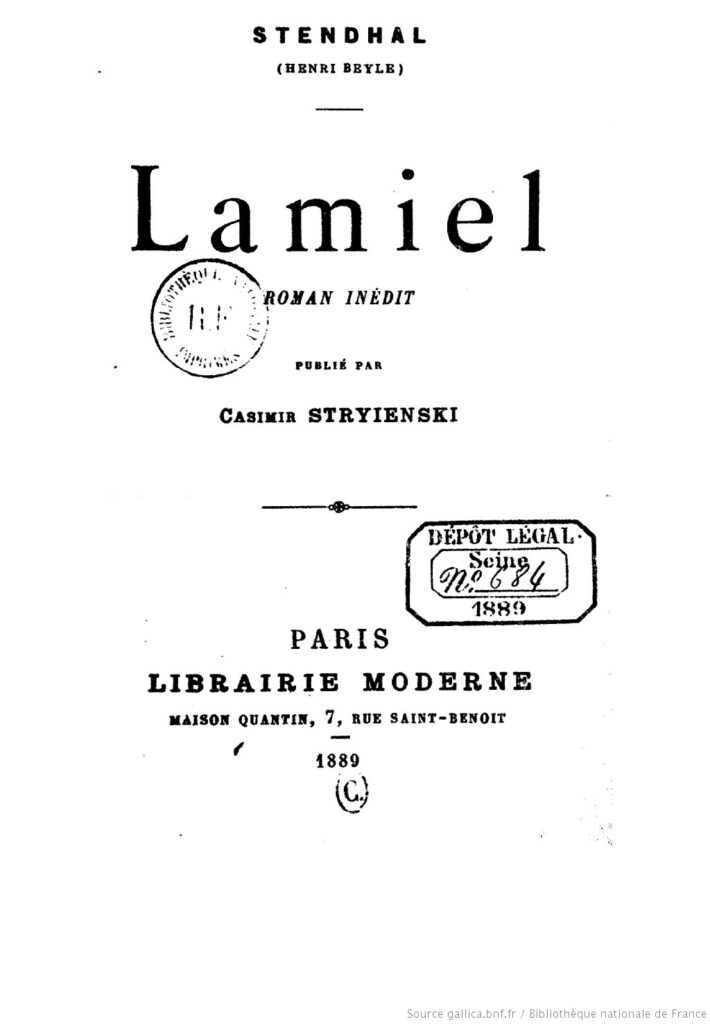
Dix ans plus tard, dans son roman, Lamiel, écrit en 1839-1840 et laissé inachevé à sa mort, Stendhal décrit une fille du peuple lectrice, Lamiel. Celle-ci apprend à lire avec son oncle, bedeau du village, laïque payé dans l’église pour éduquer des enfants ; elle lit tout ce qui lui tombe sous la main et adore les romans de la bibliothèque de colportage. Ce savoir, rare à la campagne, va la faire remarquer. Elle devient lectrice de la duchesse de Miossens, et complète ainsi son éducation auprès de différents voisins. Il avait prévu de la faire s’enfuir avec le fils de la duchesse, fou amoureux d’elle dont elle faisait son lecteur, inversant les rôles, puis de la faire devenir une courtisane célèbre et riche à Paris, soucieuse de toujours s’instruire, une « fille du feu », pleine d’énergie et de désir de savoir. Un pendant féminin de Julien en tant que lectrice du peuple gravissant les échelons sociaux grâce aux livres et au pouvoir qu’ils confèrent. Un personnage très positif qui tranche avec les nombreux romans du XIXe qui attribuent aux héroïnes lectrices une fin funeste et une perte certaine.
Stendhal est donc aussi un défenseur de l’éducation des femmes. Grand lecteur épris d’héroïsme, il valorise de façon rare ces personnages de lecteurs, qu’ils soient de nouveaux lecteurs venus du peuple, tel Julien, ou des femmes de la noblesse. Loin des nombreux romans décrivant la déchéance de ceux qui tentent de sortir de leur classe, la lecture leur permet de se rêver un autre destin et d’agir pour renverser les barrières. Ils se donnent des modèles célèbres, gravissent les échelons de la société et tentent d’ouvrir le champ des possibles, de changer leur condition sociale pour parvenir à réaliser leurs rêves. Quel plus bel hommage à la lecture que d’être le déclencheur de cette énergie, tandis que d’autres la peignent comme la source du « mal du siècle », Stendhal en fait le moteur d’êtres enflammés, en quête d’idéal au milieu d’une société bourgeoise.
Sandrine Aragon
Sorbonne Université
[1]. Lire Roger Chartier (dir), Lectures et lecteurs dans la France d’Ancien Régime, Le Seuil, 1987. L’ordre des livres, Lecteurs, auteurs, bibliothèques en Europe entre XIVe et XVIIIe siècle, Alinéa, 1992.
[2]. Voir Sandrine Aragon, Des Liseuses en péril, images de lectrices dans les textes de fictiion (1656-1856), Honoré Champion, 2003 (750 p.) ou Daniel Gestin, Scènes de lectures, le jeune lecteur en France dans la première moitié du XIXe siècle, Presses universitaires de Rennes, 1998.
[3]. Stendhal, Le Rouge et le Noir, Belin, Gallimard, p 30 : « Rien n’était plus antipathique au vieux Sorel, il eut peut être pardonné à Julien sa taille mince, peu propre aux travaux de force, et si différente de celle de ses ainés ; mais cette manie de lecture lui était odieuse, il ne savait pas lire lui-même. ».
[4]. Stendhal, Le Rouge et le Noir, Belin Gallimard, 2019, p. 31 ; toutes les citations renvoient à cette édition.
[5]. Ce roman de Bernardin de Saint-Pierre a connu un énorme succès au XIXe siècle. Il est même considéré comme l’œuvre la plus à même de séduire les classes populaires. Balzac en fait la lecture qui a transformé la pieuse héroïne Véronique Graslin dans Le Curé du village en 1839 ; Lamartine décrit cette œuvre comme celle propre à transporter toute une famille de pêcheurs siciliens illettrés dans Graziella (1852).
[6]. Mathilde de la Môle est une jeune noble intelligente, un bas bleu, selon l’expression à la mode au début du XIXe siècle. « Bas bleu » est une expression calquée sur l’anglais, « Blue stocking », en référence à un lord anglais qui fréquentait le salon de lady Montagu à Londres et portait des chaussettes bleues, l’expression va désigner les femmes intellectuelles, celles qui ont beaucoup lu et interviennent dans les salons. Elles reprennent des traits des précieuses au XVIIe et des femmes savantes. De nouveau, les personnages se développent dans les romans, alors que dans les salons de la Restauration, elles prennent de l’importance, suite à la célébrité de Germaine de Staël puis au succès de George Sand. Balzac écrit de Modeste mignon (en 1844) « Un bas bleu ! d’une instruction à épouvanter, qui a tout lu ! qui sait tout… en théorie ».
[7]. Balzac, Béatrix, « Folio », Gallimard, 1979, p. 97.
[8]. Henri Martineau écrit : « Parmi tous ses contemporains, il en est peu dont Stendhal ait plus parlé que Mme de Staël,… il en est presque hanté. Visiblement il ne l’aime pas. Il reconnaît cependant son mérite et subit son prestige. »
[9]. Du livre De l’influence des passions sur le bonheur, de Mme de Staël, il écrit : « C’est un livre terriblement enflé, (c’est à dire dont les expressions exagèrent les pensées et les sentiments). Ce défaut est le pire de tous à mes yeux », Stendhal, Correspondance, Victor Del Litto, p. 64.
[10] J.-J Rousseau, Émile ou de l’éducation, livre V, Garnier Flammarion, 1966, p. 235.
[11]. P.-G. Castex, « Le Rouge et le Noir » de Stendhal, SEDES, 1970, p. 166.
[12]. Stendhal Correspondance, vol 2, p. 218.
[13]. Stendhal, Notes et pensées posthumes, [In] La Femme au XIXe siècle, Liania Levi et Sylvie Messinger, 1983, p. 51.
[14]. Stendhal, Correspondance, vol 2, p. 243.

Bonjour, il est dommage que certaines images ne s’affichent plus. Cet article est très regardé pour le bac.
Bonjour,
Merci de nous avoir prévenus.
Toutes les images ont été rétablies.
Bien cordialement,
L’École des lettres