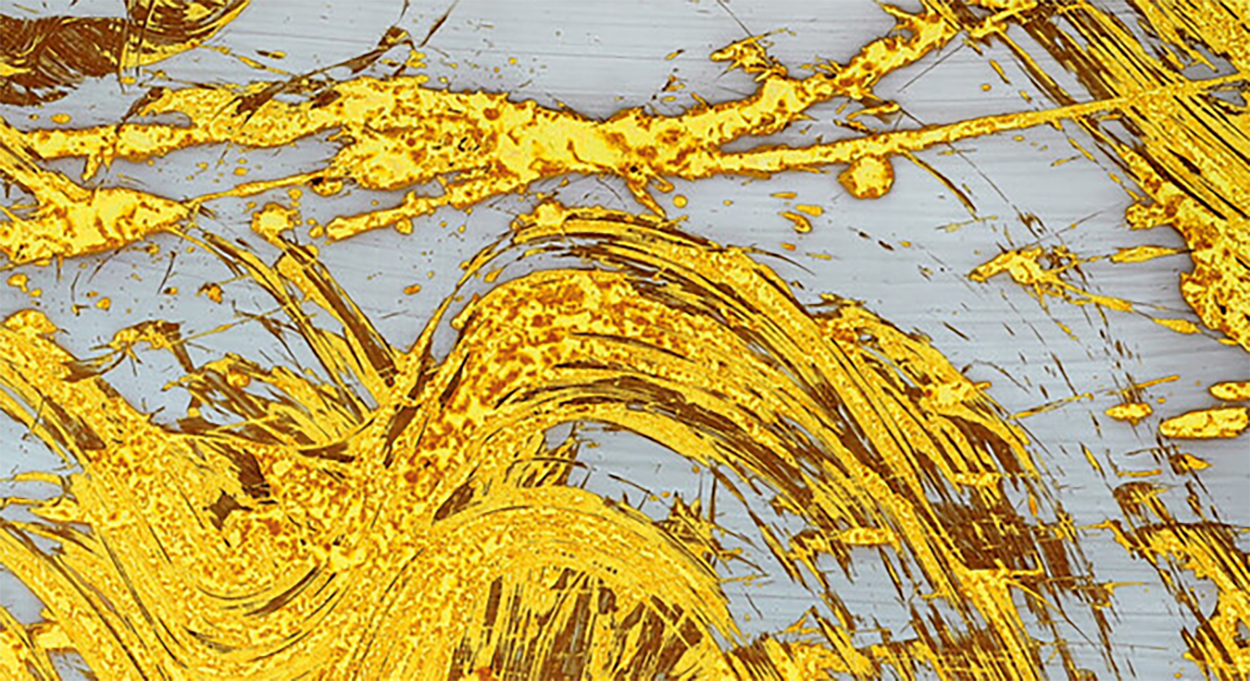
Printemps des poètes 2024 :
moments de grâce avec Paul Claudel
et Christian Bobin
Par Alain Beretta
Démarrée le 9 mars, après une polémique sur le choix de Sylvain Tesson comme parrain, la 25e édition du Printemps des poètes se tient jusqu’au 23 mars sur le thème de la grâce. Gros plan sur Paul Claudel et Christian Bobin, à un siècle d’intervalle.
Par Alain Beretta
Issu du grec choris, puis du latin gratia, le mot « grâce » désigne au départ la reconnaissance qu’on obtient de quelqu’un, la faveur librement accordée à une personne. Ce sens subsiste toujours quand, par exemple, un président de la République accorde une remise de peine à un condamné. À l’origine, cette grâce était divine : elle signifiait le don gratuit de Dieu aux personnes répondant à son appel, et ainsi s’opposait au sens superficiel d’une grâce extérieure, en particulier physique.
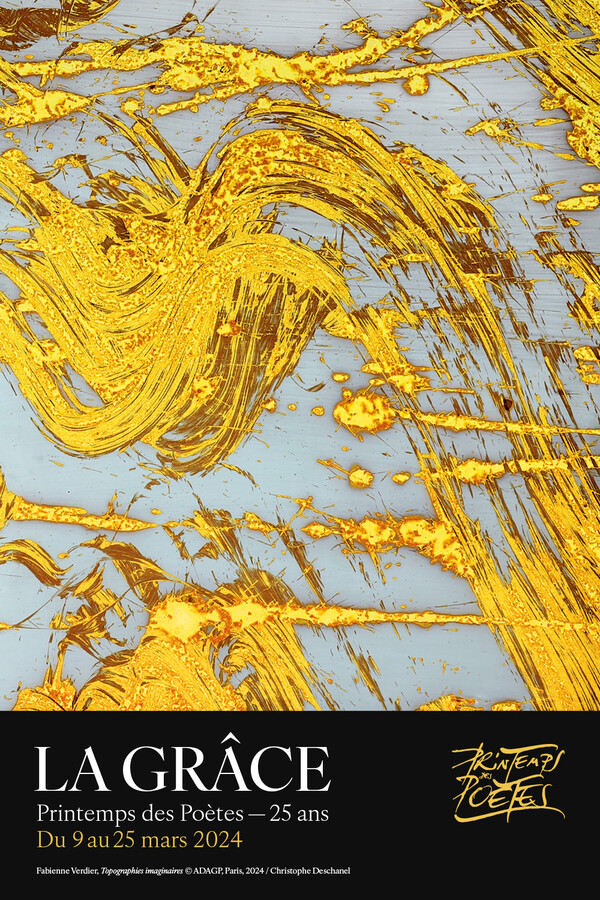
Dans la Bible, au « Livre des Prophètes », Salomon déclare : « Mensongère est la grâce de la beauté : seule la femme craignant Dieu mérite des éloges ». Cette grâce divine, aide surnaturelle de Dieu, est donc accordée aux hommes pour leur salut, car « c’est par la grâce que Jésus est mort pour nos péchés », dit la Bible.
Au fur et à mesure du déclin de l’omnipotence religieuse, le mot « grâce » a revêtu un sens humain. C’est toujours une disposition à faire des faveurs, mais d’individu à individu, simplement pour être agréable à quelqu’un. En conséquence, la grâce a été associée à une apparence souriante et à la beauté physique, à l’instar des Trois Grâces antiques. Plus généralement, la grâce suggère un charme indéfinissable, une disposition à une légèreté, sublimée notamment par la danse : la philosophe Simone Weil oppose la grâce à la pesanteur dans son ouvrage La Pesanteur et la grâce.
Transcender nos imaginaires
Louant charme et beauté, la grâce semble prédisposée à inspirer les poètes. L’ex-directrice artistique du Printemps des poètes, qui vient d’en démissionner du fait de la polémique autour de la présidence de la manifestation proposée à Sylvain Tesson, Sophie Nauleau, affirme que grâce et poésie invitent à « transcender nos imaginaires et nos vies. Le mythe de l’inspiration a longtemps caractérisé le poète, touché par la grâce ». À l’origine, cette expression avait un sens religieux, désignant la qualité de l’âme d’un chrétien n’ayant aucun péché mortel sur la conscience. Au sens moderne, c’est devenu l’état d’une personne à qui tout réussi ou, du moins, un instant de grande intensité, quasi exceptionnel.
De fait, nombre de poètes ont célébré la grâce, dans son sens profane. La grâce religieuse est restée cantonnée dans les prières et cantiques. La littérature classique retient pourtant le Poème sur la Grâce (1720), de Louis Racine, le fils du grand dramaturge. Prétendant mettre en vers saint Augustin et saint Thomas, il veut appeler ses lecteurs à rechercher la grâce divine, commençant son poème par : « Ô vous qui ne cherchez que ces rimes impures […], Profanes ! Loin d’ici je vais chanter / la Grâce. »
Hormi ce texte, les poètes associent traditionnellement la grâce à la beauté féminine. Au XVIe siècle, Ronsard, dans Sur la mort de Marie, célèbre la rose en écrivant : « La grâce dans sa feuille et l’amour se repose ». Au début du siècle suivant, Malherbe évoque une « Beauté de qui la grâce étonne la Nation ». La poésie moderne a dépassé ce cliché pour illustrer le sens, plus profond, de la grâce comme état de disponibilité totale, pleinement absorbée par l’instant.
C’est le cas d’un des premiers poèmes de Rimbaud, « Sensation » (1870), qui évoque ainsi cette plénitude : « Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers / […] Je ne parlerai pas, je ne penserai rien / Mais l’amour infini me montera dans l’âme ». L’ivresse poétique est une grâce.
Afin d’analyser plus précisément comment la grâce est ressentie en poésie, considérons le cas de deux poètes qui s’en sont revendiqués, à un siècle d’intervalle, les débuts des XXe et XXIe siècles : Paul Claudel et Christian Bobin.
La grâce en question : Paul Claudel, Cinq grandes odes (1910)
Paul Claudel est un poète et dramaturge capital du XXe siècle : un prix en son nom vient d’être créé, et sera remis au printemps à une production de poésie dramatique. Écrivain chrétien par excellence, il a en effet reçu la grâce divine à 18 ans (en 1886), alors qu’il assistait à un office de Noël à Notre-Dame de Paris : la foi a fondu sur lui pour ne jamais disparaître, au point qu’il a envisagé, quelques années plus tard, de suivre une vocation monastique.
Comme il n’en a pas été jugé digne, il repart en 1900 en Chine pour retrouver ses fonctions diplomatiques, et, sur le bateau qui l’y emmène, il subit un autre coup de foudre, amoureux cette fois : il s’éprend d’une femme mariée, mère de famille, Rosalie Vetch, avec laquelle il va vivre quatre ans, avant qu’elle le quitte. Dès lors, le poète s’est trouvé écartelé entre la morale chrétienne et une liaison coupable. Ce dilemme se manifeste notamment dans le recueil Cinq grandes odes, écrit entre 1905 et 1908, et publié en 1910, en particulier dans la quatrième ode, « La Muse et la Grâce ».
Dans la première ode, « Les Muses », le poète s’adresse aux neuf muses, en les tutoyant. L’invocation reflète d’abord les visites de Claudel dans les abbayes où il pensait devenir moine, mais quand surgit la muse Erato, on voit poindre le bateau où il a rencontré Rosalie : « Erato ! tu me regardes, et je lis une résolution dans tes yeux ! ». La deuxième ode, « L’Esprit et l’eau », reprend, en la dominant, la crise centrale du poète. L’eau, soit la mer infinie, représente une libération du péché : Dieu seul nous libère du contingent, mais, dans notre vie, nous sommes séparés de lui. La troisième ode, « Magnificat », cherche une conciliation : le devoir poétique est de trouver Dieu en toutes choses et de les rendre assimilables à l’Amour, mais il faut alors répondre à l’appel de la grâce.
Ivresse poétique
C’est ainsi que cette quatrième ode se présente sous la forme d’un dialogue, d’un combat entre le poète et sa Muse. Composée en 1907, c’est la seule des cinq odes qui est structurée en une alternance de trois strophes (le poète) et de trois antistrophes (la Muse). Au début, le poète se trouve envahi par une ivresse poétique qu’il tente d’écarter : il demande à la Muse de le laisser à son devoir humain, et, à la place de son âme, il lui offre l’univers entier.
Mais la Muse lui rétorque : « Je ne suis pas accessible à la raison, tu ne feras point de moi ce que tu veux ». Le poète s’oppose vigoureusement à cette parole : « Je ne veux point ! va-t’en de moi un peu ! ne me tente pas ainsi cruellement ! ». La Muse tente alors de le ramener à elle en lui expliquant : « Tu m’appelles la Muse et mon autre nom est la Grâce, la grâce qui est apportée au condamné […] Je suis la parole de grâce qui est adressée à toi seul », rappelant ainsi au poète son devoir de sanctification. Mais, dans l’épode qui clôt cette ode, ce dernier se bouche les oreilles à cette invitation, préférant se retourner vers la terre : « Va-t’en ! tu ne m’ôteras point ce froid goût de la terre […] qu’il y a dans la moelle de mes os » : l’amour humain et charnel l’a donc emporté. La culpabilité subsiste cependant car, dans la dernière ode, « La Maison fermée » (1908), le poète veut demeurer « entre les hommes comme une personne sans visage ».
La grâce célébrée : Christian Bobin
Christian Bobin (1951-2022) se définit comme « le poète de l’émerveillement », cette grâce qui lui fait savoir admirer les choses simples de la vie. Comme Claudel, il est animé par une foi, qui se confond chez lui avec la contemplation : « C’est ne pas me remettre d’être sur terre, c’est d’être étonné comme un nouveau-né. » Cet étonnement s’égrène au fil d’une soixantaine d’ouvrages, mi-essais, mi-poèmes en prose, qui lui ont valu deux prix : celui de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre (2016), et le Goncourt de la poésie (2023, à titre posthume). Une brève évocation d’un de ses premiers recueils, puis du tout dernier, peut approcher ce perpétuel état de grâce.
L’Enchantement simple (1986)
Ce titre, réédité en 2001 dans la collection « Poésie/Gallimard », se suffit à lui-même pour suggérer l’émerveillement procuré par une contemplation des choses les plus simples. Il en va ainsi de ce que lui offre la nature, sous ses yeux, et qu’il lui suffit de nommer : « Les arbres du jardin. La douceur qui gouverne chaque feuille. Les fruits sur la table, atteints par une légère couche d’or ». Face à cette offrande, « les choses n’ont plus d’épaisseur. Tout est simplifié dans cette blanche lumière de l’abandon ». Parfois, la nature enchante tellement le poète, qu’il lui semble qu’elle le pénètre : « Quelque chose de l’automne entre dans l’âme, avec la lumière : le goût d’une vie claire et chantante. »
Autre source d’état de grâce : la musique classique. « Matinée avec Haydn, symphonie n° 94. Les ailes cassantes de la musique. Dieu plus léger que l’air ». De même, toujours avec Haydn, cette fois dans ses sonates jouées par le grand pianiste Glenn Gould, la musique, comme la nature, pénètre l’âme, qui « glisse au fond du corps […] ; les mots n’ont plus cours à ce niveau de langage ». Une telle admiration de ce qui s’offre n’implique pas pour autant une sorte de naïveté béate qu’on a parfois attribuée à Bobin. Sa compagne, la poétesse Lydie Dattas, le dit bien dans la préface de l’édition Poésie/Gallimard de L’Enchantement simple : « Ce n’est pas parce que la vie est rose qu’il faut la chanter, mais bien parce qu’elle est tragique ».
Le Murmure (2024)
Jusque dans cet ultime texte, paru tout récemment, le 1er février 2024 (Gallimard), Christian Bobin, alors pourtant en proie à la maladie, semble avoir conservé une forme de grâce. Il a écrit ce recueil de fragments (sa méthode habituelle) en grande partie sur son lit d’hôpital, où il est mort le 23 novembre 2022. Et pourtant, dans Le Murmure, pas de traces de cette terrible épreuve, pas d’effroi ni de résignation : Bobin attend la mort sans faillir, dans une sérénité incroyable, qui fait dire à son médecin, médusé : « Avec ce que vous avez, vous devriez être terrassé ». Sa foi religieuse contemplative y est certainement pour quelque chose : Bobin s’était fait connaître en 1992 par Le Très-Bas, consacré à saint François d’Assise.
Ce qui impressionne particulièrement dans ce que le poète « murmure », c’est combien, à la fin de sa vie, il se revit, se revoit un nouveau-né découvrant le monde avec éblouissement : « Moi-même, qui comme un nouveau-né, ne suis que regard, j’ai force et GRÂCE de donner en écrivant ce regard que je cherche partout ». Certes, à l’hôpital, la nature lui est devenue moins présente, mais la musique le plonge toujours dans un état de grâce. Tout spécialement, le génie du pianiste Grigory Sokolov, très souvent cité, lui donne l’impression de lui transfuser du Chopin, lui faisant retrouver là encore « l’électrique attention du nouveau-né » ; mais « l’ai-je jamais perdue ? », ajoute-t-il. C’est ainsi que Bobin fait des variations sur le sourire, tutoie les arbres et les nuages qu’il admire depuis son lit médicalisé, veut trouver délicieux les plats incomestibles qu’on lui sert, et pense à des noisettes avant d’être opéré.
Espérons qu’un peu de cette grâce évoquée par les poètes rebondira sur la célébration de leur Printemps afin de dominer, voire dissiper, la polémique autour de leur parrain. Car une centaine d’événements sont prévus en France et dans les pays francophones, sur le plan scolaire, de la maternelle au lycée. De grâce, sauvons la poésie, qui elle-même « sauvera le monde », comme l’affirme le poète Jean-Pierre Siméon, ex-directeur artistique de cette manifestation.
A. B.
L’École des lettres est une revue indépendante éditée par l’école des loisirs. Certains articles sont en accès libre, d’autres comme les séquences pédagogiques sont accessibles aux abonnés.
