
Les Brontë en Pléiade (tome 3) :
Charlotte à la recherche de voies nouvelles
Par Stéphane Labbe, professeur de lettres (lycée Bossuet, Lannion)
Avec un riche appareil critique, les deux récentes traductions de Shirley et Villette font apparaître un réalisme social inédit confinant au romantisme industriel dans le premier et, dans le second, la liberté absolue et la modernité de l’aînée de la fratrie.
Par Stéphane Labbe, professeur de lettres (lycée Bossuet, Lannion)
Les éditions Gallimard ont publié fin 2022 de nouvelles traductions des deux derniers romans de Charlotte Brontë, Shirley et Villette* achevant ainsi une publication de ce qui pourrait passer pour les œuvres complètes des Brontë. Signées Laurent Bury et Véronique Béghain, ces deux traductions sont d’autant plus appréciables que les deux romans n’avaient pas été revisités depuis les années cinquante.
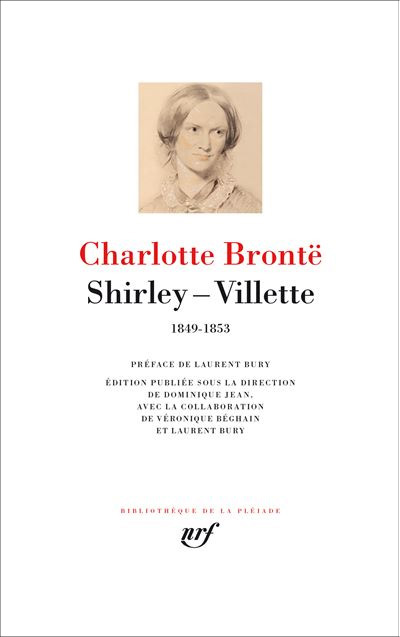
La préface générale de Laurent Bury, qui insiste sur le laboratoire que furent les Juvenilia (l’ensemble des œuvres de jeunesse, quantitativement plus importantes que la somme publiée du vivant des sœurs), est intéressante. Le traducteur montre notamment que les veines fantastique et réaliste coexistaient déjà dans ces écrits de jeunesse. Elle souligne également la dimension hétéroclite de ces « œuvres complètes » dont la publication s’est échelonnée sans réel souci de cohérence sur plus de vingt ans.
Le second volume qui contenait certains épisodes de ces Juvenilia s’avérait bien trop sélectif, sachant que des épisodes majeurs comme The Green Dwarf ou Stancliffe’s Hotel[1] y étaient ignorés. De la même manière, les choix très restreints effectués dans la poésie d’Emily[2] ne permettaient pas de rendre compte de l’évolution d’une œuvre qui constitue sans doute le sommet de l’œuvre brontëenne.
Shirley ou le « romantisme industriel »
Si l’on peut effectivement percevoir une continuité dans l’œuvre de Charlotte, l’aînée de la fratrie qui survécut à ses cadets décédés au cours de l’année 1848-1849, on aurait tort de sous-estimer le poids du deuil sur ces œuvres dites de la maturité. Charlotte Brontë a écrit toute sa vie, mais la mort de ses frère et sœurs (celle d’Emily particulièrement) l’a profondément déstabilisée. Elle alterne des périodes de dépression et d’hyperactivité qui rendent difficile l’élaboration de Shirley, le premier des deux romans publiés. La traduction alerte de Laurent Bury lui confère un certain rythme. Il faut pourtant reconnaître que ce roman peine à trouver sa dynamique et qu’on n’y retrouve pas les ressorts dramatiques qui avaient fait le succès de Jane Eyre.
Charlotte Brontë, peut-être pour suivre les conseils du philosophe et critique littéraire George Henry Lewes[3], a renoncé à la veine gothique. Elle ancre son roman dans un réalisme social qui, jusque-là, n’avait jamais été sa priorité. Elle y évoque les conflits luddites opposant dans les années 1811-1812 les artisans du Yorkshire aux manufacturiers qui introduisaient l’usage du métier à tisser dans la fabrication des textiles. À cet arrière-plan historique, la narration vient greffer une intrigue sentimentale qui confronte l’héroïne du roman (Caroline Helstone) au personnage éponyme (Shirley). L’apparition de celui-ci dans le roman est assez tardive.
Beaucoup de critiques ont défendu l’idée selon laquelle Shirley serait une vision idéalisée d’Emily. L’héroïne et son modèle supposé ont un point commun : une certaine masculinité (Shirley est originellement un prénom masculin). De même qu’on surnommait Emily le « major » dans la famille Brontë, Shirley Keeldar est surnommée le « commandant » dans son milieu. Cette jeune héritière libre de disposer de sa personne fascine Caroline, comme Emily fascinait son aînée. Sa désinvolture, son manque d’intérêt pour les conventions rappellent également la figure d’Emily. Mais, si le lecteur peine à s’attacher à cette figure, c’est sans doute, comme le montre Laurent Bury dans l’étude qui suit, parce que la romancière ne donne jamais accès aux sentiments et pensées du personnage. Et Shirley Keeldar reste, aux yeux du lecteur, une énigme dont le comportement et les décisions manquent parfois de cohérence.
Shirley est sans doute le roman de Charlotte Brontë qui se rapproche le plus de la poétique de Jane Austen dont on sait pourtant qu’elle n’appréciait guère les romans. On y retrouve la même verve satirique (chez Charlotte Brontë, c’est l’Église anglicane qui en fait les frais) et une abondance de scènes romanesques dont les dialogues font ressortir valeurs et travers des personnages.
La « notice » de Roland Bury s’avère extrêmement éclairante pour mettre en valeur les centres d’intérêt de l’œuvre. Il y invente la notion de « romantisme industriel » et montre que l’esthétique du roman cultive de manière timide une revendication sociale, tout en manifestant à la fois la laideur et la grandeur de la modernité industrielle. Cette ambivalence correspond aussi à celle qui habite des personnages pris dans le mouvement de l’industrialisation et nostalgiques en même temps d’une Angleterre bucolique dans laquelle régnaient encore les fées.
Le traducteur relève aussi la dimension féministe d’un roman qui commence par présenter, en une suite de tableaux satiriques ou réalistes, la misogynie ordinaire de la société anglaise. Il montre que le roman met en scène une véritable « revanche du féminin », suivant en cela l’itinéraire précédemment tracé par Jane Eyre. Les héroïnes féminines s’affirment, gagnent en vitalité, quand les héros masculins (Rochester, Robert Moore ici) s’affaiblissent au point de s’inscrire dans une relation de dépendance à leurs compagnes.
Villette, le roman d’une jeune femme « sans véritable passé ni avenir ».
Villette, le dernier roman de Charlotte Brontë, sera quant à lui composé entre 1851 et 1852. D’aucuns, comme Virginia Woolf, le tiennent pour le chef-d’œuvre de l’autrice. Mais, une fois encore, il semble plus difficile de s’attacher aux pérégrinations de Lucy Snowe, l’héroïne du roman, qu’à la trajectoire de Jane Eyre. Il faut dire, comme le note la traductrice Véronique Béghain, que l’héroïne est une jeune femme « sans véritable passé ni avenir ». Le roman, particulièrement elliptique, revient en réalité sur la déchirante expérience bruxelloise de Charlotte Brontë. Élève, puis répétitrice au pensionnat de Madame Héger, à Bruxelles, elle était tombée amoureuse de M. Héger qui l’avait repoussée sans ménagement.
L’héroïne se fait engager comme gouvernante dans une école pour jeunes filles située à Villette, au royaume de Labbassecour. L’école, dirigée par Mme Beck (Madame Héger dans la vie), offre à la jeune narratrice l’occasion d’une série de portraits satiriques et matière à une intrigue assez lâche. Celle-ci tourne surtout autour de l’histoire d’amour déconcertante qui se noue entre elle et le versatile Monsieur Paul, professeur d’arithmétique présenté comme un cousin de Madame Beck – on y reconnaît évidemment Monsieur Héger.
Charlotte Brontë retrouve un peu de la veine gothique de Jane Eyre, en soumettant son personnage à de cruels tourments psychologiques et en la confrontant à l’horrifiante figure du spectre d’une religieuse qui semble hanter les combles du pensionnat. Mais le gothique a surtout pour fonction de symboliser le mal-être de l’héroïne. Obsédée par ses fantômes intérieurs, elle se sent en décalage dans le pensionnat de Villette et refuse de toutes ses forces les hypocrisies d’une société minée (selon elle) par un catholicisme dévastateur.
On ne s’étonnera pas que Villette ait pu susciter l’admiration de Virginia Woolf, l’autrice y fait preuve d’une liberté absolue et semble se moquer de produire ou non une illusion référentielle. Charlotte Brontë a sans doute cherché en écrivant ce roman à dépasser le traumatisme qu’avaient suscité en elle une passion inavouable et le rejet de Constantin Héger. Ce faisant, elle met l’accent sur le trouble, le sentiment de déperdition du personnage et offre à ses lecteurs un roman sans véritable fin, dont les prémonitions surréalistes ont déconcerté les lecteurs de son temps. Le dossier documenté de Véronique Béghain fournit des clés de lecture pertinentes et montre l’étrange modernité de ce roman lui aussi trop méconnu.
Cette édition des deux romans de Charlotte Brontë est sans doute le meilleur des trois opus consacrés aux sœurs Brontë en Pléiade. Les traductions soignées, précises et modernes faciliteront la lecture de textes déconcertants pour le lecteur de Jane Eyre. L’appareil critique solide offre une approche universitaire éclairante qui avait fait défaut jusqu’alors à ces deux œuvres tardives.
Cependant, une véritable édition des œuvres complètes de la sororie reste à faire, et les poèmes d’Emily (dans une moindre mesure ceux de la cadette Anne) mériteraient d’être enfin traduits intégralement en français. Une publication raisonnée et exhaustive des Juvenilia reste aussi à entreprendre, ne serait-ce que pour montrer à quel point Laurent Bury a raison d’y voir un prodigieux laboratoire littéraire.
S. L.
Charlotte Brontë, Shirley – Villette, sous la direction de Dominique Jean, avec la collaboration de Véronique Béghain et Laurent Bury. Trad. de l’anglais (Royaume-Uni) par Véronique Béghain et Dominique Jean. coll. « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, 1 392 p., 70 euros.
Ressources
- Agnès Grey, d’Anne Brontë, réédité en poche.
- Emily, de Frances O’Connor : âme révoltée dans les landes anglaises
- Les « Cahiers de poèmes » d’Emily Brontë
- Initiation au commentaire à partir d’un extrait de Jane Eyre, de Charlotte Brontë (3e-2de).
- Emily Brontë : l’incipit des Hauts de Hurle-Vent
- Emily Brontë : Les Hauts de Hurle-Vent Séquence
- Emily Brontë en France
Notes
[1] Publié en français aux éditions du Rocher en 2004, dans une traduction de Philippe Mikriammos.
[2] Janet Gezari a fourni une excellente édition de l’intégralité des poèmes d’Emily Brontë, sous le titre The Complete Poems, chez Penguin en 1992.
[3] Cf. sa réponse au critique dans Lettre choisie de la famille Brontë (Folio,2020, trad. de Constance Lacroix) p. 231.
