« Un papa de sang », de Jean Hatzfeld
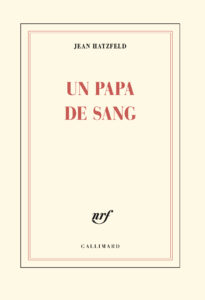 Une enfance propice aux inquiétudes
Une enfance propice aux inquiétudes
Cinquième livre de Jean Hatzfeld consacré au génocide tutsi, Un papa de sang fait entendre la voix des enfants vivant vingt ans après le crime, dans les collines de Nyamata. Certains sont les fils et filles des rescapées. Tel est le cas d’Immaculée, d’Ange, de Sandra ou de Nadine. Les autres sont enfants de bourreaux encore en prison, comme le père de Fabiola ou de Fabrice, ou libérés après les procès organisés dans les gaçaças, ces tribunaux populaires suppléant aux manques d’une justice affaiblie, après le génocide.
Ces jeunes ont à peine vécu les événements de 1994 ; ils sont parfois nés au Congo lors de la fuite devant les troupes du FPR, ont été adoptés ou ne peuvent se rappeler ce temps. Tous vivent dans le même lieu, marqué par les souvenirs et traces. Ils se parlent peu du passé, essaient de vivre au présent.
Contourner la difficulté de la parole
Le narrateur, qui est d’abord auditeur, les interroge selon un « dispositif » qui sans doute contourne la difficulté de la parole. Il les situe d’abord dans un cadre, et l’on croise quelquefois Englebert, témoin principal du précédent récit (qui paraît cet automne en “Folio”). Les parents sont là, également. Puis les jeunes racontent. Ils disent la vie quotidienne, le travail ou les études, c’est selon.
Beaucoup d’entre eux ont vu leur avenir brisé par ce passé douloureux. Surtout les enfants de Hutus. La politique de l’État favorisait les victimes en leur payant les Minervals, frais d’étude dans ce pays issu de la colonisation belge. Ils tiennent la parcelle familiale, s’occupent d’agriculture ou d’élevage. Tous ces enfants restent près de leurs parents, aident au quotidien, y consacrent le dimanche.
On est loin de Kigali : les objets de la modernité font rêver : « On convoite beaucoup l’Internet », explique Sandra. Elle peut en disposer brièvement, mais s’interdit d’aller sur des sites montrant les horreurs de l’époque, qu’il s’agisse des catastrophes naturelles ou des crimes commis ici ou là par les humains.
Sa prévention est partagée par beaucoup. À la télévision, qu’ils voient peu, ils aiment les séries indiennes pour la vision idyllique qui est donnée de l’amour. Ils aiment danser, jouer au football, dans le cadre très restreint qui est le leur.
« Nous avons grandi esseulés dans une enfance hostile »
La foi est en revanche une constante, chez les enfants de survivants comme chez ceux des assassins. Face à ce que le génocide a d’incompréhensible, c’est une clé. Comme le dit Jean Damascène, enfant de Hutu, « un génocide attise les croyances, les gens braisent leur foi pour se protéger du fléau ». On est sidéré par la maturité de ces jeunes gens et filles, par la gravité de leur réflexion, même si le voile de la foi peut nous paraître un aveuglement. Ainsi, quand Ange parle :
« Des innocents ont été tués, des enfants ont souffert, des pauvres ont été coupés, ce n’est pourtant pas dû à une négligence de Dieu. Rien de tel n’arrive par mégarde, ni pour punition, ni par manque d’amour. Certains devaient mourir, Dieu le savait parce qu’Il sait tout. »
L’État fait tout pour atténuer les oppositions entre Hutus et Tutsis. La dénomination des ethnies a été supprimée. À l’école, les professeurs évitent les jugements moraux et relatent les faits sans commentaires. Les élèves visitent les mémoriaux, voient les lieux des massacres, mais on évite ce qui pourrait devenir conflictuel. Ce n’est d’ailleurs pas nécessaire. Au fil des récits, reviennent les mots de méfiance, peur, voire rancoeur ou jalousie. Certains échanges verbaux sont acerbes : les Hutus reprochent aux Tutsis de bénéficier des aides financières ; les Tutsis aimeraient avoir des grands-parents et une famille sur lesquels prendre appui.
Au mieux, « on se contourne par commodité ». La relation avec le passé et les actes des parents n’est pas la même. Ainsi Ange note-t-elle à propos des Hutus que « les précisions zigzaguent chez eux ». Enfin on doit vivre avec les rumeurs, les récits qui trainent et qui pèsent sur les enfants : « les racontars grouillaient », raconte Fabiola. Fabrice, né au Congo dans une famille hutue dit en une formule sa solitude : « Nous avons grandi esseulés dans une enfance hostile. »
Jusqu’à quel point faut-il savoir ?
Cette solitude est également partagée. Les familles des uns ont été détruites, celles des autres évitent de parler. La transmission se fait dans une sorte d’obscurité ou de brouillard. Nadine, apprenant qu’elle est issue d’un viol emploie la métaphore précise : « J’ai pénétré dans les ténèbres du génocide. » Jusqu’à quel point faut-il savoir ? Certains enfants veulent tout connaître, apprendre les moindres détails. Tous savent qu’ils sont le « produit » du génocide. Comme le dit Ange, « aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours été gênée par une chose un peu considérable qui me serait arrivée ». Elle se tient à l’écart des commémorations, craint le « brouhaha des foules », l’émotion qui prévaut par exemple pendant la semaine du deuil.
Le témoignage de Sylvie, survivante élevée par des parents adoptifs fait partie des nombreux moments forts du livre. Elle refuse de faire porter le poids des récits à ses enfants :
« Les parents ont choyé mon enfance. Ils m’ont enveloppée de l’amour de la vie. Peut-être ai-je tenté de les imiter. J’ai pensé, les machettes ont tué mes parents. Pas la force qu’ils m’ont donnée. Ce que les oreilles de mes enfants doivent entendre, elles l’écouteront ailleurs. Moi, je dois les éduquer comme je l’ai été. Je veux que la vie s’étire en longueur pour eux sans le sang. »
« L’humain ne se débarrasse jamais d’une existence animale passée »
L’avenir de ces jeunes est pourtant compromis. Ils cherchent à s’éloigner de ces collines, rêvent de Kigali ou du Canada, n’imaginent pas de mariage qui leur donnerait un beau-père bourreau ou survivant. Tous sont sur le « qui-vive ». les traces sont vivaces : « L’humain ne se débarrasse jamais d’une existence animale passée », dit la jeune Sandra. Et selon Nadine, « de mauvaises pensées se tiennent en embuscade les mauvais jours ».
Un papa de sang est un livre magnifique et puissant, un livre, osons le dire, même si cela ressemble à un cliché, dont on ne sort pas indemne. Il pose des questions sur cette « histoire surnaturelle », sur les génocides en général, sur les tentatives d’explication qu’on leur donne, par le savoir, par la croyance, sur la transmission, sa nécessité, son impossibilité, parfois. C’est un livre qui donne à penser, longtemps.
Norbert Czarny
• Jean Hatzfeld, “Un papa de sang”, Gallimard, 2015, 266 p.
Voir sur ce site :
• Enseigner le génocide des Tutsi au Rwanda, du collège à l’université.
• « Englebert des collines », de Jean Hatzfeld, par Norbert Czarny.
• « Robert Mitchum ne revient pas », de Jean Hatzfeld, par Norbert Czarny
