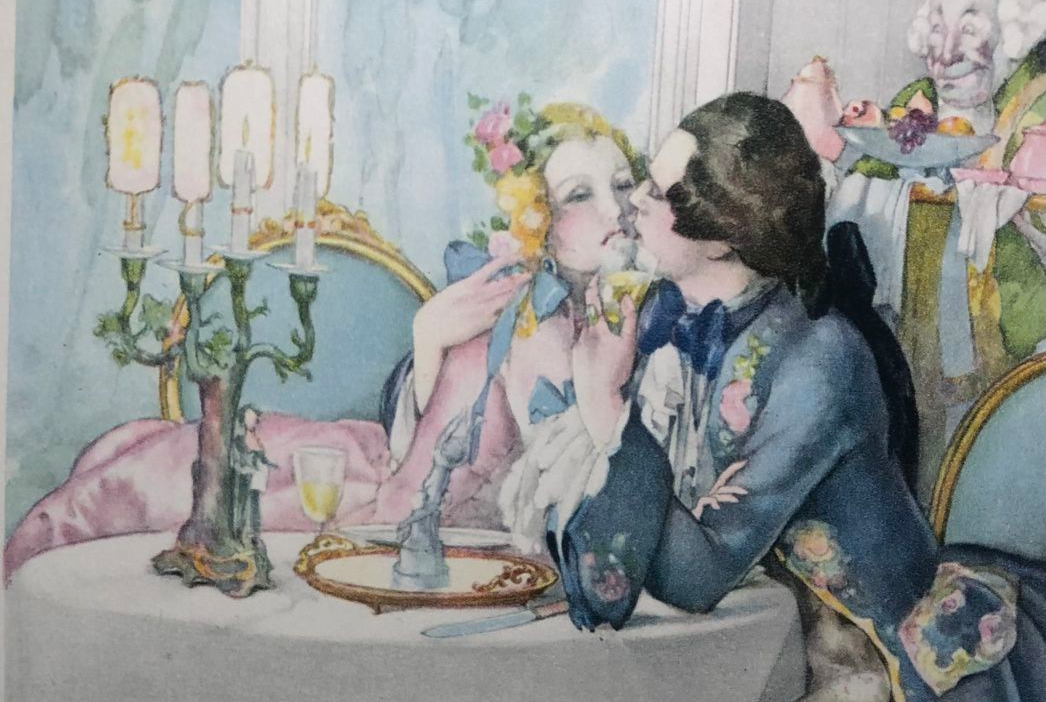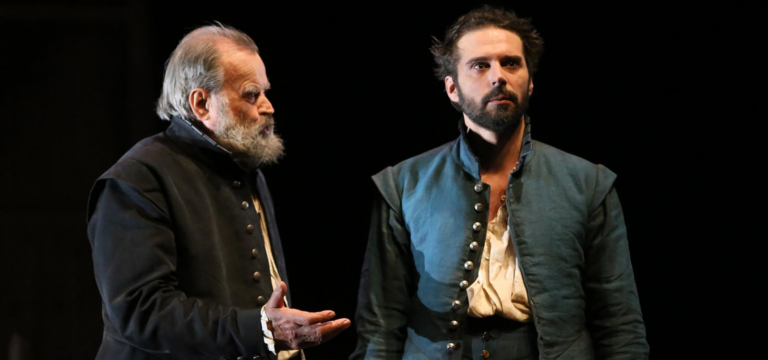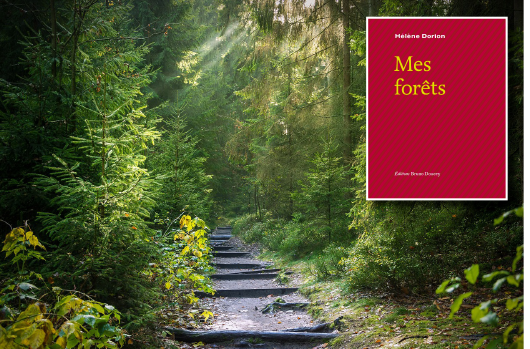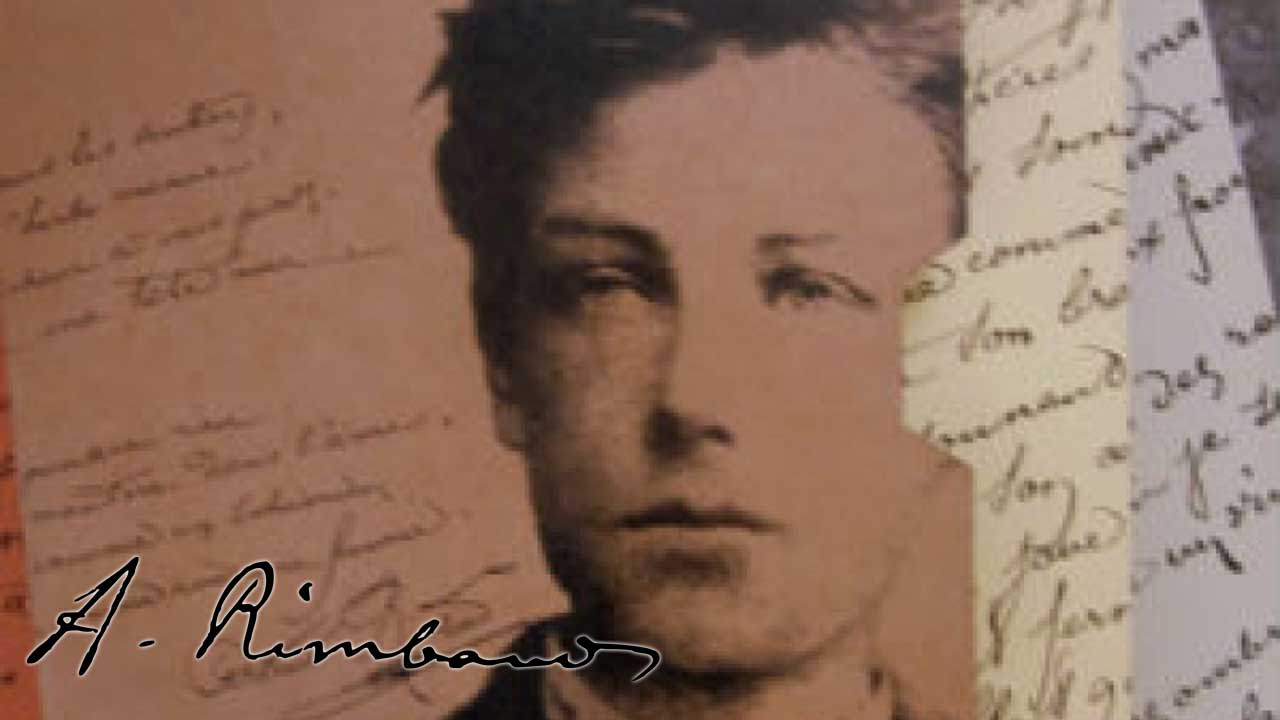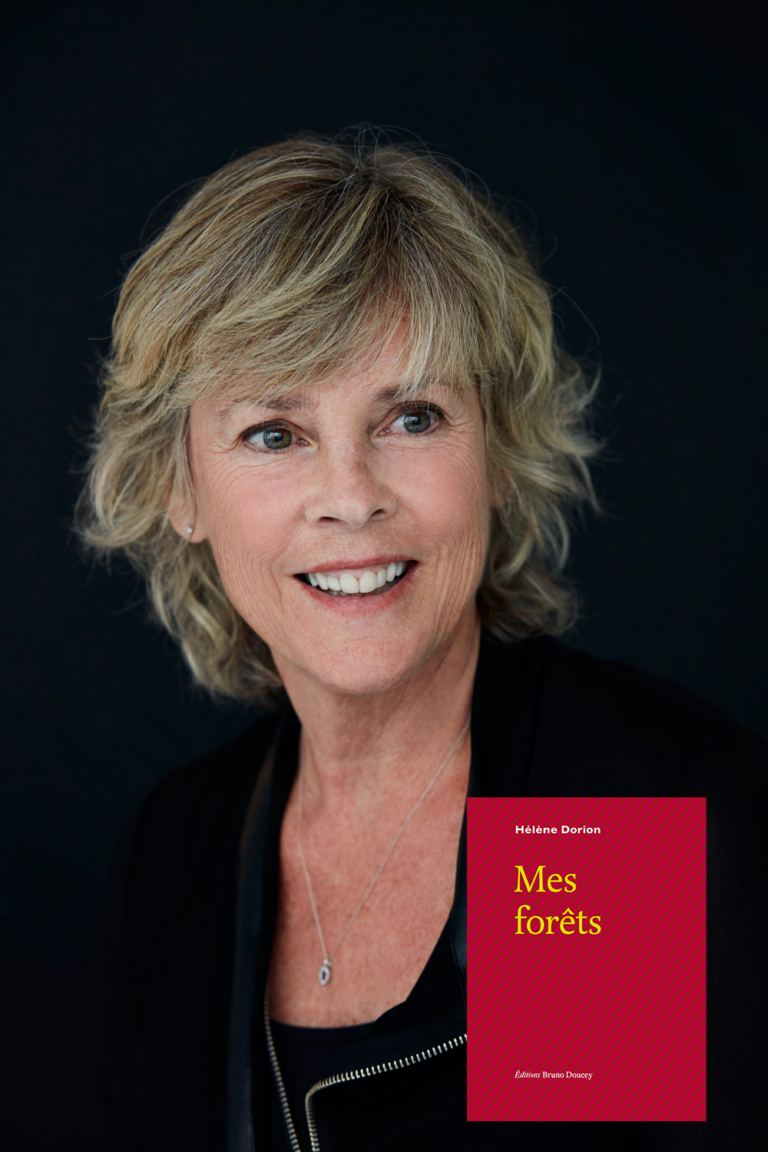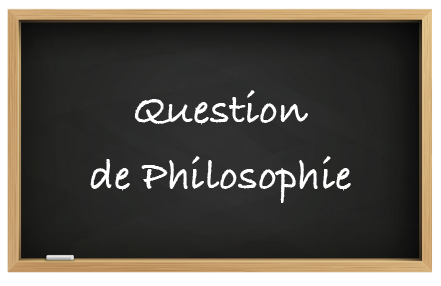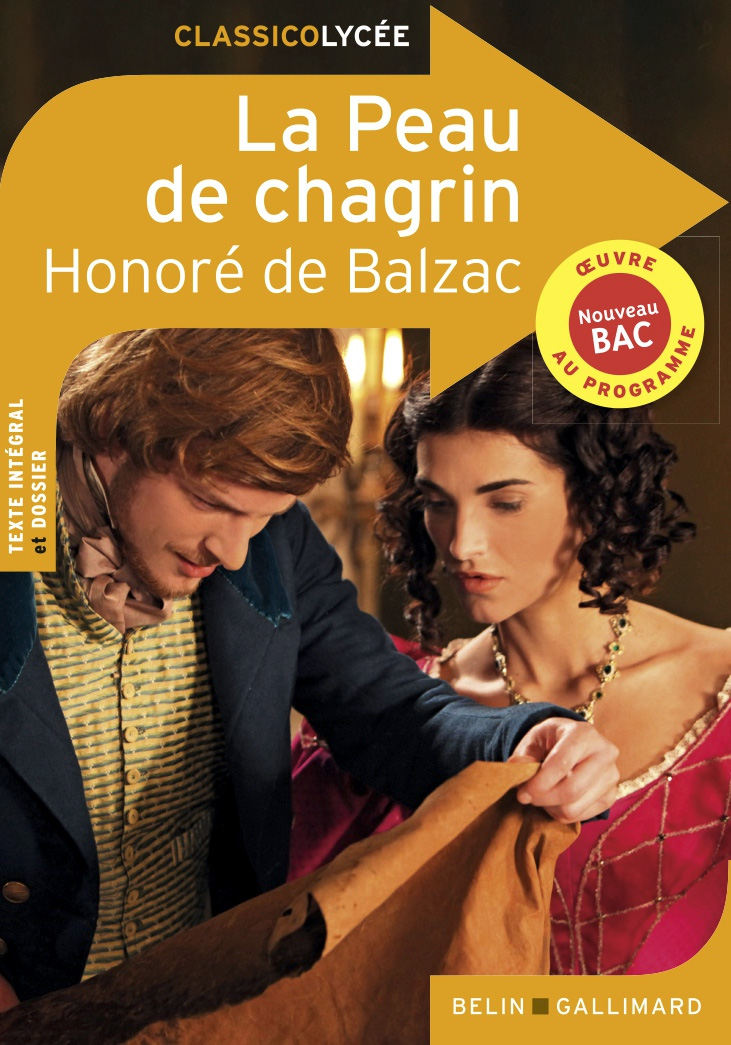Le manga Naruto, de Masashi Kishimoto.
L’adolescent en quête d’identité
Un manga tel que Naruto n’est pas une autobiographie, mais il peut sensibiliser les lycéens au thème de la quête de l’identité. Il peut ainsi les introduire à une lecture plus autonome des écritures autobiographiques, au programme de la seconde bac pro.
Par Édith Taddei, professeur de lettres et formatrice à l’Inspé (académie de Versailles)
Par Édith Taddei, professeur de lettres et formatrice à l’Inspé (académie de Versailles)