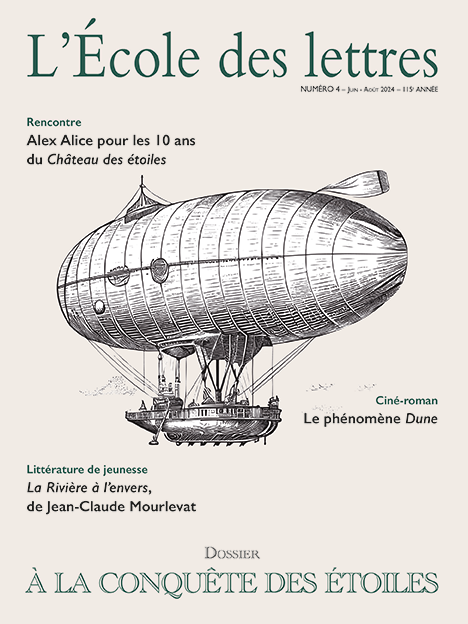
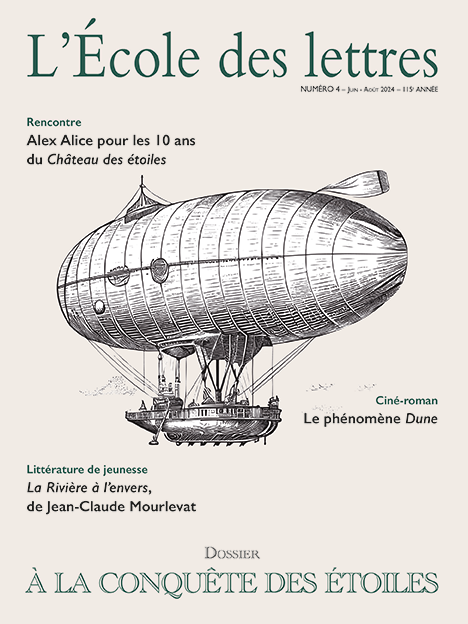

Alex Alice : « C’est sur cette frontière de l’inconnu que je plante mon récit »
Enfant, il rêvait d’aller sur la Lune. Aujourd’hui, il y envoie les personnages du Château des étoiles. Sa série en bande dessinée, qui fête ses dix ans, part ensuite en expédition sur Mars, dans un Paris où flottent des machines volantes, et bientôt dans la jungle de Vénus. Rencontre avec Alex Alice.
Propos recueillis par Ingrid Merckx, rédactrice en chef
Propos recueillis par Ingrid Merckx, rédactrice en chef

Premier alunissage littéraire crédible : De la Terre à la Lune, de Jules Verne
La Lune fascine des écrivains depuis quatre siècles. Au milieu du XIXe siècle, Jules Verne, soucieux de vulgariser les connaissances scientifiques, a imaginé un voyage vers notre satellite, initiant une littérature d’anticipation qui s’avérera florissante.

Éric Pessan, Et les lumières dansaient dans le ciel : besoin d’espace
Elliott, un jeune adolescent qui vit mal la séparation de ses parents, se réfugie dans l’observation des étoiles. Il assiste à des phénomènes nocturnes dont
il tente de percer le secret. Parcours autour d’un roman en apesanteur.
Par Inès Hamdi, professeure de lettres au collège Victor-Hugo à Noisy-le-Grand (93)
Par Inès Hamdi, professeure de lettres au collège Victor-Hugo à Noisy-le-Grand (93)

« Ad Astra » :
comment les Anciens envisageaient le ciel
L’astronomie poursuit un but : donner aux marins et aux cultivateurs
une connaissance pratique des signes célestes. Aux origines, terre et ciel
ne faisaient qu’un. Encore aujourd’hui, le désir est cette « séparation loin
de l’étoile », ce manque qui nous distancie de ce que nous recherchons.
Par Haude de Roux, professeure de lettres (Paris)
Par Haude de Roux, professeure de lettres (Paris)

Les premiers pas sur la Lune…
de Cyrano de Bergerac
Longtemps avant Hergé, Cyrano de Bergerac (le vrai) écrit Voyage dans la Lune qui fait date au point que la pièce éponyme d’Edmond Rostand y fait référence lors d’une scène truculente. Comment établir en classe un lien entre l’hypotexte et l’hypertexte, en visant à enrichir l’imaginaire des élèves ?
Par Antony Soron, maître de conférences HDR, formateur agrégé de lettres, Inspé Paris Sorbonne-Université
Par Antony Soron, maître de conférences HDR, formateur agrégé de lettres, Inspé Paris Sorbonne-Université

La conquête de l’espace :
une arme stratégique pendant la guerre froide
Les avancées fulgurantes des années 1960 sont fonction d’une bataille technologique et idéologique opposant les Américains et les Russes,
mais aussi les citoyens est-allemands et ouest-allemands. Ce que montre
avec humour le film Good bye Lenin ! de Wolfgang Becker, sorti en 2002.
Par Jean-Riad Kechaou, professeur d’histoire-géographie à Chelles (77)
Par Jean-Riad Kechaou, professeur d’histoire-géographie à Chelles (77)

Des étoiles plein les bulles
La bande dessinée n’a eu de cesse de mettre en scène l’espace.
Du rêve au cauchemar, de la terre au ciel, embarquez dans cette mission spatiale pour un voyage à travers plusieurs titres hauts en couleurs, en coups de crayon et mots célestes.
Par Inès Hamdi, professeure de lettres au collège Victor-Hugo à Noisy-le-Grand (93)
Par Inès Hamdi, professeure de lettres au collège Victor-Hugo à Noisy-le-Grand (93)

Le Château des étoiles, d’Alex Alice :
dans les rêves de Louis II de Bavière
Magnifique saga de bande dessinée, Le Château des étoiles, d’Alex Alice
permet d’aborder deux objets d’étude du programme de cinquième :
« Le voyage et l’aventure : pourquoi aller vers l’inconnu ? » et « Imaginer
des univers nouveaux ». De la notion d’uchronie au genre de la science-fiction.
Par Stéphane Labbe, professeur de lettres (académie de Rennes)
Par Stéphane Labbe, professeur de lettres (académie de Rennes)
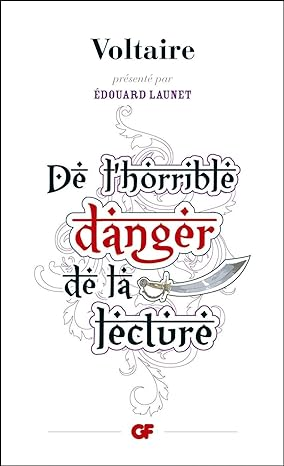
Les satires croisées de Voltaire et Hrabal :
dérision cinglante de la bêtise et de l’ignorance
À deux cents ans d’intervalle, les deux écrivains, l’un français et l’autre tchèque, ont respectivement écrit De l’horrible danger de la lecture et
Une trop bruyante solitude, textes corrosifs sur la censure des livres
qui sont une dérision cinglante de la bêtise et de l’ignorance, de la superstition et de l’obscurantisme.
Par Pascal Caglar, professeur de lettres (Paris)
Par Pascal Caglar, professeur de lettres (Paris)
