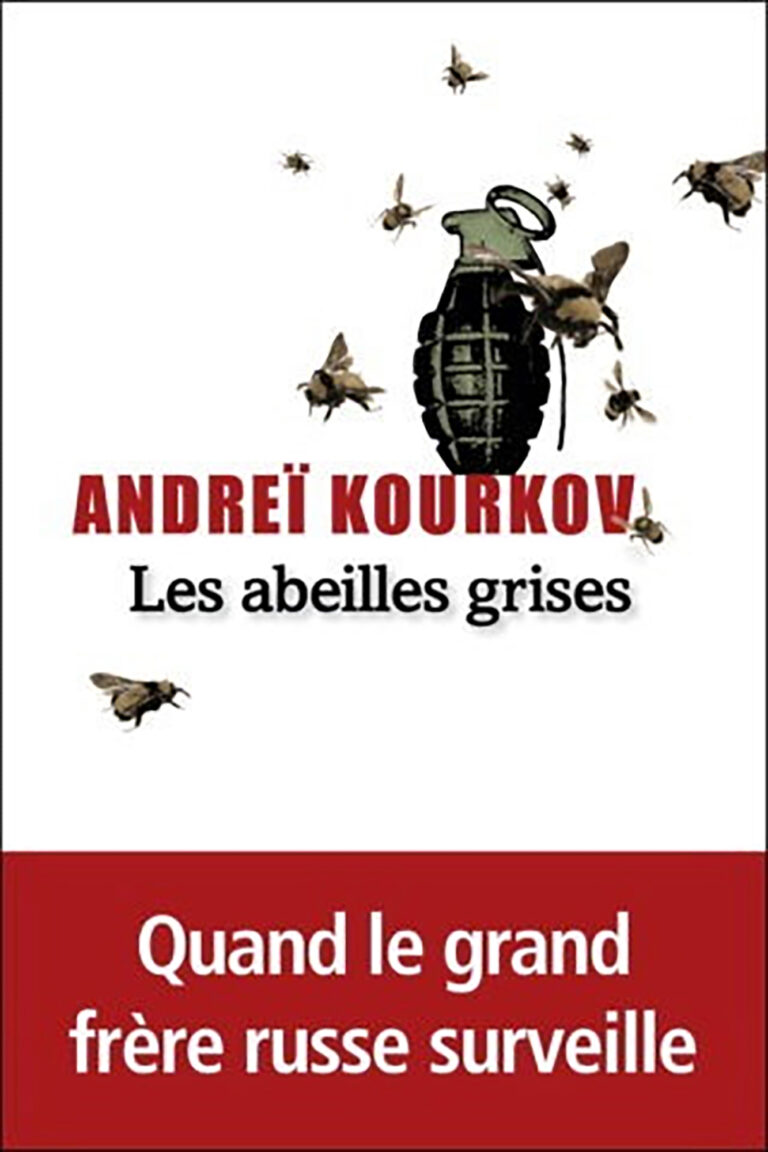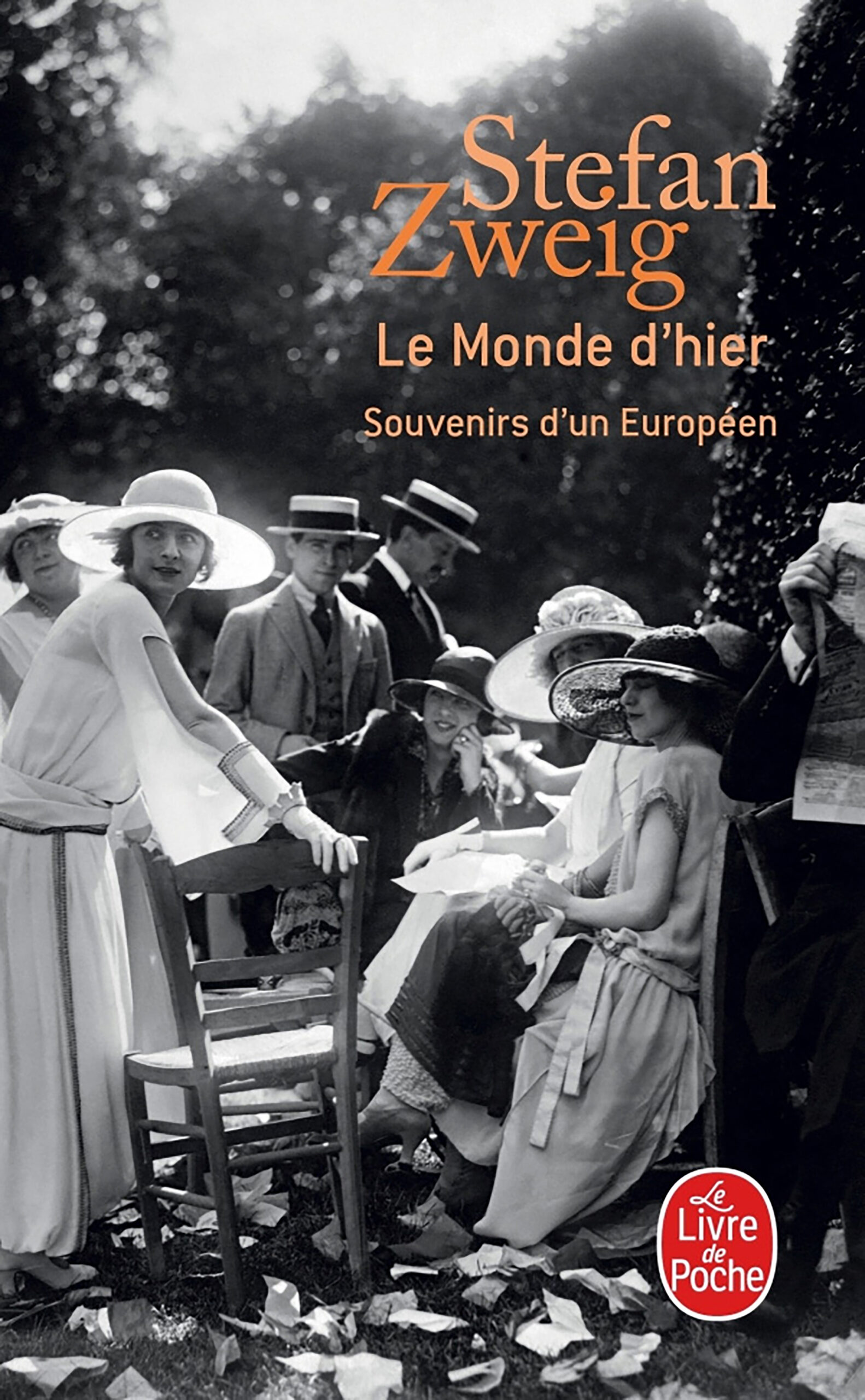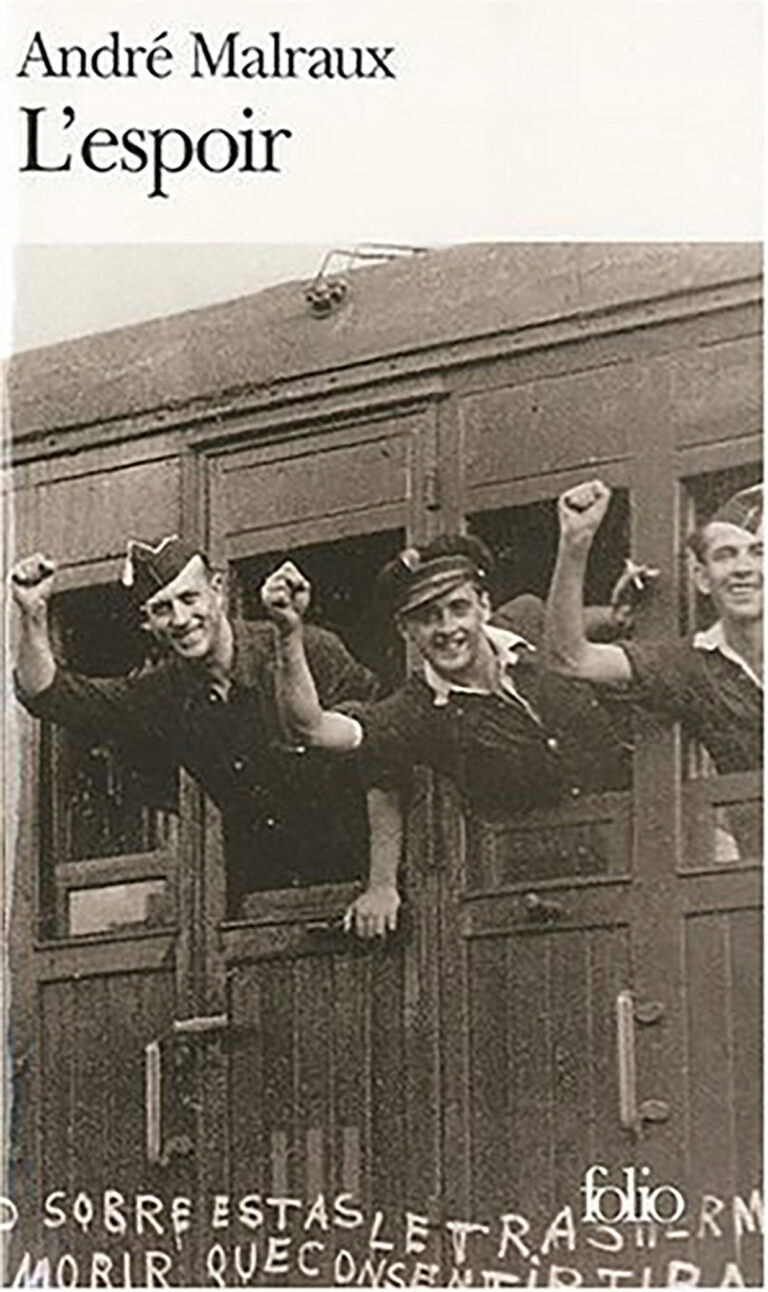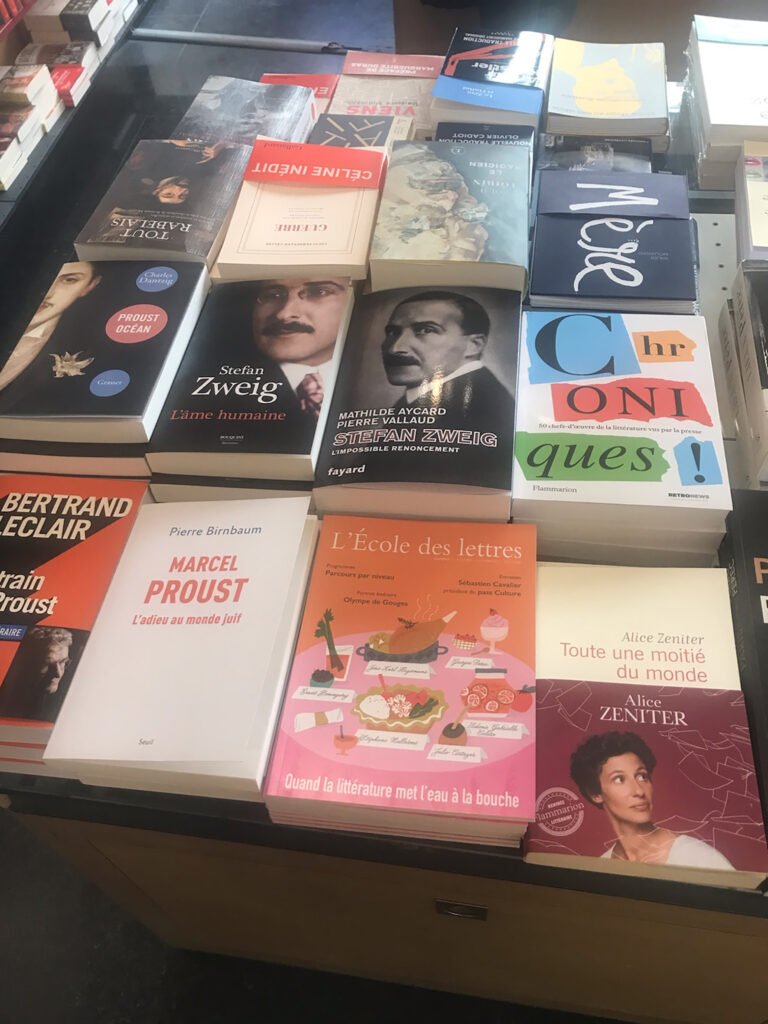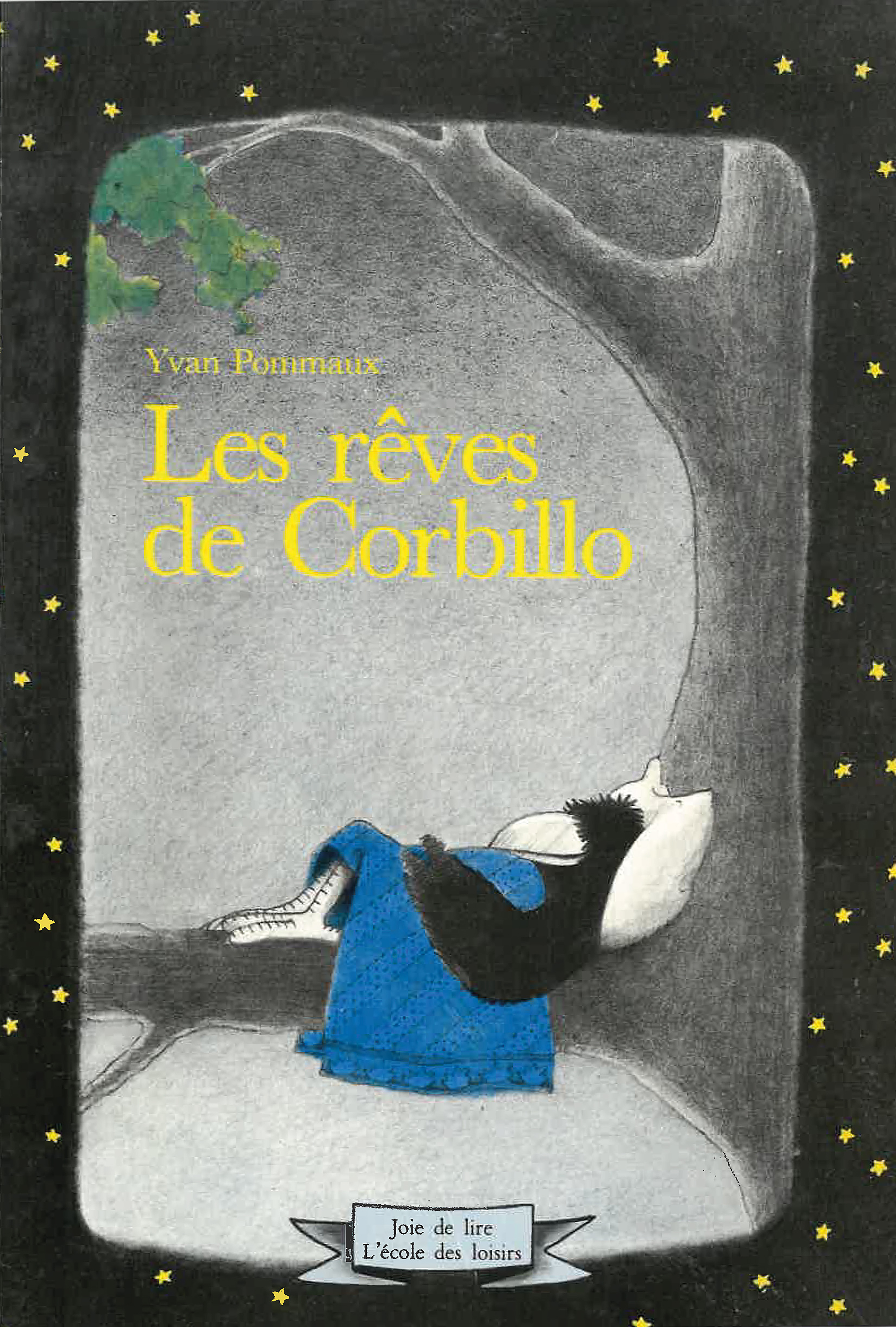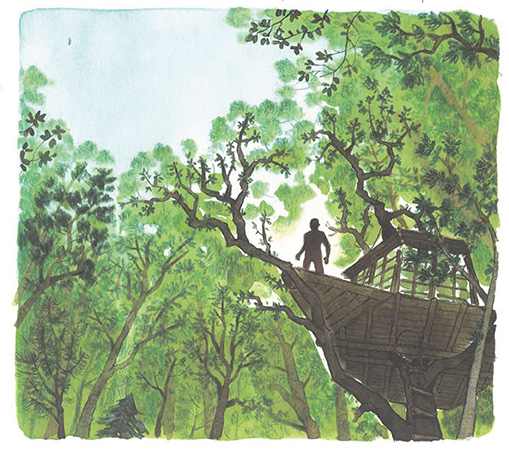
« Habiter joyeusement des clairières »
De Robinson Crusoé, de Daniel Defoe, à Deux ans de vacances, de Jules Verne, la littérature n’a cessé d’illustrer le motif de la cabane. Édifier une cabane, c’est poser un geste qui rappelle l’enfance et peut aussi engager une éthique. Quelques pistes pour une séquence sur le thème « Dans ma maison ».
Par Laetitia Malpot, professeure de lettres (Brest)
Par Laetitia Malpot, professeure de lettres (Brest)