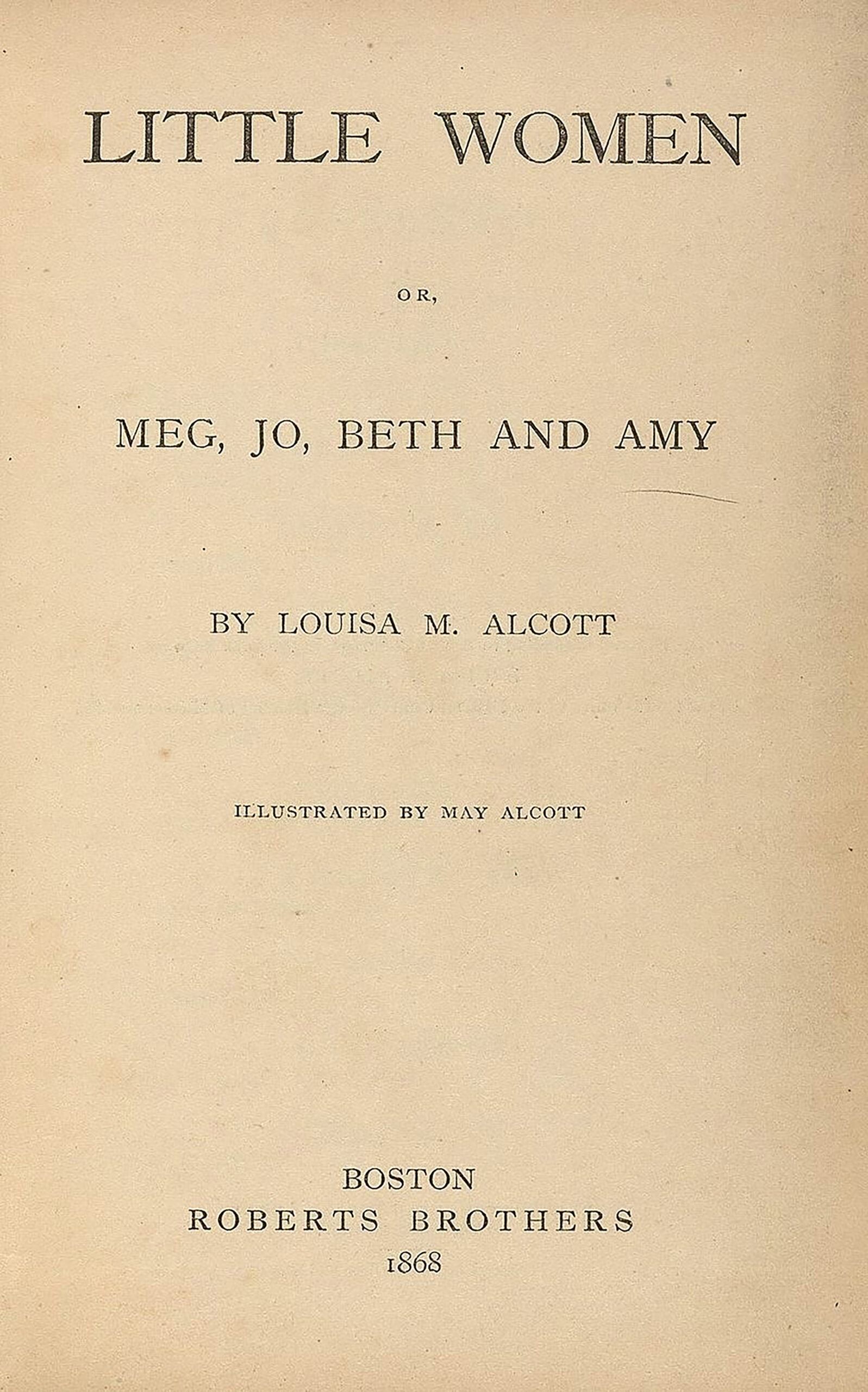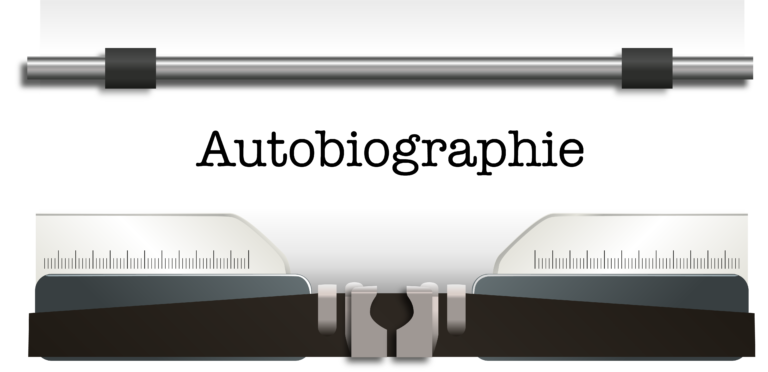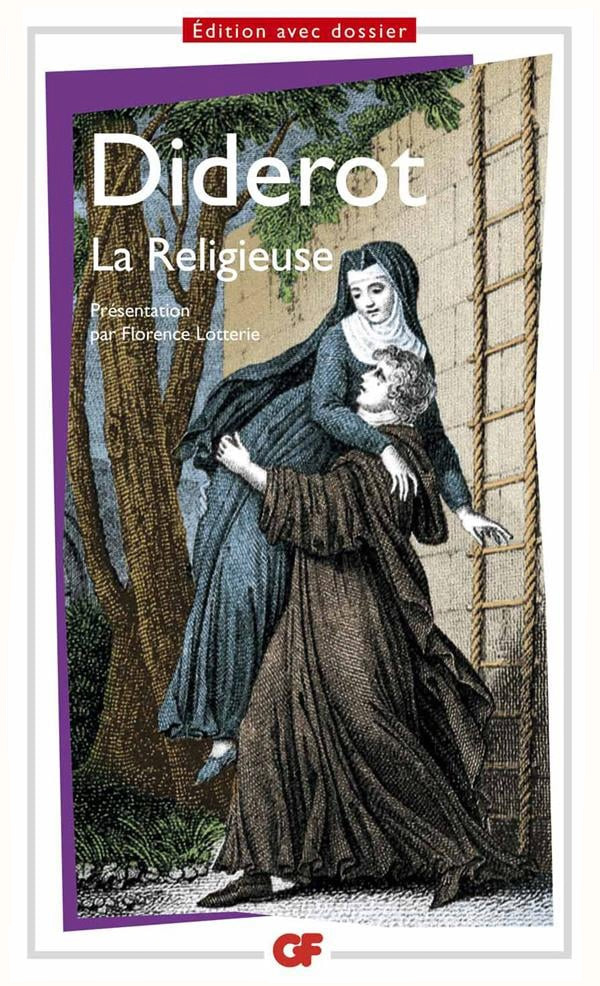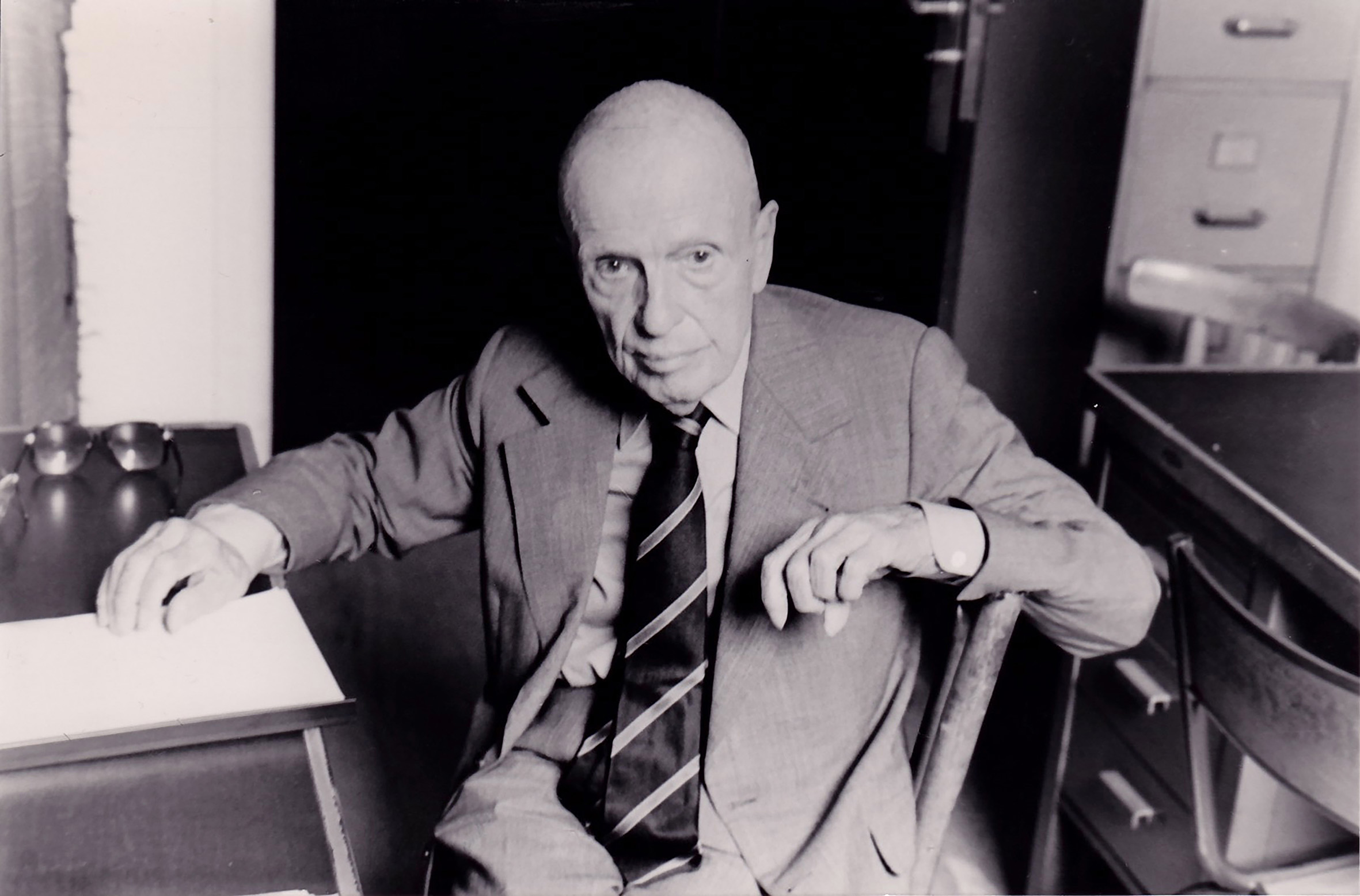
Quand l’autobiographie se fait critique : L’Âge d’homme, de Michel Leiris
Dans son autobiographie dédiée à Georges Bataille, l’écrivain ethnologue
a tenté de parler de lui-même avec le maximum de sincérité. Quitte à verser dans l’autocritique, voire l’autodérision et le sarcasme, y compris envers
ses proches.
Par Alain Beretta, professeur de lettres
Par Alain Beretta, professeur de lettres